À la recherche d’un titre

À la recherche de Mr. Goodbar

Titre original : Looking for Mr. Goodbar
Année : 1977
Réalisation : Richard Brooks
Avec : Diane Keaton, Tuesday Weld, Richard Gere
(En mode bball)
Très bon début, rythmé, du run’n mum. Pas mal de cuts dans le montage, des séquences très courtes. Pas d’action spectaculaire, mais des tactiques rapides bien mises en place.
À la fin du premier quart-temps, ça a commencé à me mettre mal à l’aise. Ça se passe dans les années 70, les années baise, la libération des soutiens-gorge. Et moi ça, ça me saoule. Diane Keaton passait d’un joueur à un autre : « un homme c’est déjà trop et un million, c’est pas assez ». Un peu perso la Diane, elle ne pense qu’à elle, au cul. Les cross avec Richard Gere sont excellents (il aurait mérité plus de temps de jeu, ou au moins d’avoir la possibilité dans sa carrière de jouer pour des équipes qui jouent pour le titre, et à part « Chicago », c’est pas à la hauteur de son talent, et de son charme…).
Vers la fin du second quart-temps, Diane Keaton se pose dans un bar. Elle lit, ou fait mine (elle attend qu’on vienne la draguer). Gere vient donc tourner autour et regarde le bouquin : Le Parrain. Et là, qu’est-ce que lui dit Gere (ESPN insider) : « Oh, j’ai vu le film. C’est vraiment très bon. Al Pacino est vraiment excellent » Ah ah.
(Pour les oublieux, je rappelle que Diane Keaton jouait l’année précédente avec Al Pacino, et qu’elle a justement gagné le titre, deux fois, avec lui pour ce film).
C’était sympa… jusqu’à la fin. Diane mène pendant tout le match et elle trouve le moyen de se faire manger sur le fil. La mort la rattrape, d’une manière assez surprenante. À force de baiser avec n’importe qui, de ramener n’importe quel voyou ramassé dans un bar, elle tombe sur un malade mentale, qui la charcute en même temps qu’il la baise, en lui sortant « allez t’en veux encore salope, hein tu en veux prends ça… » Même pas de prolongations, le match est fini comme ça, sur un buzzer beater…
Ce qui me dérange, ce n’est pas que la mort ait gagné. C’est ce que ça révèle de l’histoire, de la volonté de la gonzesse qui a écrit le bouquin. En gros avec une morale comme ça, d’une part, on a une vision passablement homophobe du personnage assassin que joue Tom Berenger (parce que c’est un homo refoulé et que forcément un homo ça doit être mal dans sa peau, et surtout, s’il est homo c’est qu’il a des problèmes psy et donc qu’il est capable de faire des trucs aussi chelous que ça…), mais en plus, alors que tout le film semble aller dans le sens de la société de la baise qui n’est jamais remis en cause pendant tout le film, parce qu’on a toujours le point de vue de Diane Keaton, et non celui de sa famille catholique…, là, le film prend un contre-pied total (bonjour les chevilles ! ankle breaker sur twist over) parce qu’en gros, avec une fin comme ça, on veut dire : « Tu l’as bien cherché, t’es qu’une pute, il fallait pas jouer avec le feu, la société de la baise, c’est mal, revenons à notre bonne vieille morale de papa… »
Sans doute écrit par une écrivaine coincée de la chatte qui se rêve des aventures au milieu des années 70 quand tout le monde le fait, et que, elle, est coincée avec son petit mari. Sur le banc. Elle s’amuse un peu, et à la fin, elle vous dit que c’était que pour rire, que finalement, on est toujours mieux chez soi, dans les bras du seul amant qu’une femme puisse avoir : son mari. Un scrimmage pour finir par du garbage time. Les sports collectifs, c’est mal.


Looking for Mr. Goodbar, Richard Brooks (1977) | Paramount Pictures
Liens externes :






 Année : 1977
Année : 1977
 Année :
Année : 


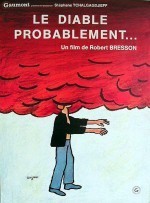
 Année : 1977
Année : 1977