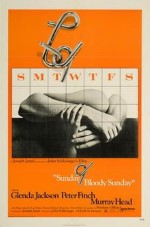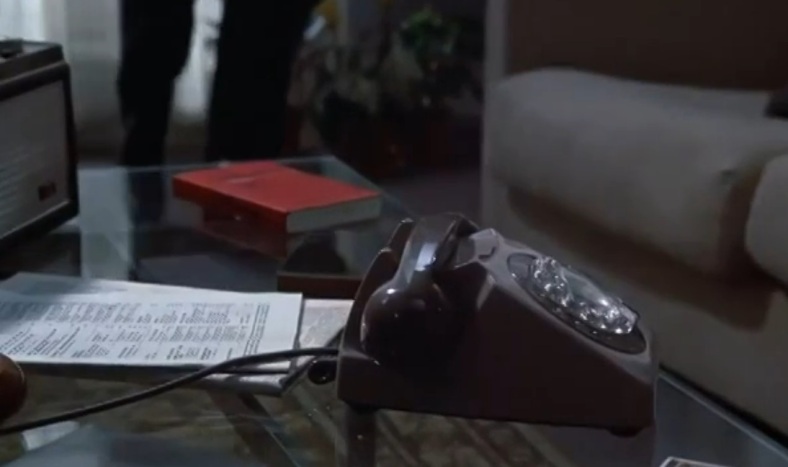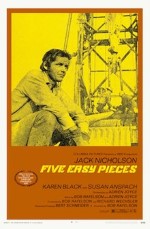La Source d’Heghnar
Titre original : Heghnar aghbyur / Հեղնար Աղբյուր
Titres anglais alternatifs : Heghnar Spring / The Spring Heghnar
Année : 1971
Réalisation : Arman Manaryan
Avec : Sos Sargsyan
Adaptation d’un texte de ce qui semble être un écrivain arménien soviétique d’importance : Mkrtich Armen. Je reste assez circonspect, ou sur ma faim (pour ne pas dire autre chose).
Le film présente une indéniable singularité, mais il apparaît aussi parfois un peu inabouti ou, par instant, confus et maladroit. Le symbolisme de la fable (on aime bien la fable en Arménie à ce que je vois) n’aide pas à rendre les choses plus claires : j’ai historiquement du mal à percevoir, identifier, déchiffrer les codes quand ils se cachent trop bien à mon attention, et quand mon ignorance ne me facilite pas non plus la tâche.
À première vue, la morale de La Source d’Heghnar pourrait… couler de source, mais trop d’éléments épars échappent encore à une cohérence propre. Et ne pas comprendre a le don de me plonger dans l’inconfort… Parce que certes « la femme est une source à laquelle seul le mari peut boire », je l’ai, tu me laisses deux secondes pour digérer la puissance anti-woke de l’argument, mais ça reste encore limpide. À côté de cet élément, ça devient déjà plus flou. Le film contient une révélation finale qui prend le contre-pied de ce qui précède : l’histoire, alors teintée d’une solennité spirituelle, voire mystique, adopte tout à coup une approche rationaliste toute soviétique. Même si jusque-là l’hypothèse de l’entourloupe charlatanesque avait forcément pu jaillir dans l’esprit du spectateur pour donner un sens à ce « miracle », je ne vois pas bien en quoi ce basculement brutal vers la rationalité éclaire le reste de la fable. Que devient la morale du film ? Entre « méfiez-vous des faux prophètes » et « ma femme m’appartient », deux sujets s’affrontent, et un choix s’impose.
De la même manière, l’histoire ne nous montre pas si le mari a tué sa compagne ou si elle meurt… de honte. Pourquoi faire mystère des circonstances de son décès et euphémiser cet épisode loin d’être anodin en l’évinçant intégralement de la « fable » ? Pourquoi, par ailleurs, le paysan a-t-il pris une telle importance dans le premier tiers du récit ? Tout ce qui présente sous la forme de conte, de fable, de parabole, d’apologue ou de mythe s’encombre rarement d’éléments superflus. Or, notre fable fonctionnerait tout aussi bien sans ce détour malheureux consacré au paysan qui agit comme une fausse piste alors que l’événement prend une place centrale au début du film. L’art du récit consiste pour beaucoup à un art des justes proportions. Peut-être la signification de cet étrange écart m’échappe-t-elle ici… Mais j’ai comme l’idée qu’une introduction doit livrer, en creux ou non, tous les éléments de sa conclusion. Si une fausse piste ou une histoire parallèle se greffe à l’entrée en matière, le récit n’évitera pas la confusion.

C’est d’ailleurs dès l’entame du film que cette confusion s’installe. Elle est certes volontaire parce que le récit a recours à des actions muettes pour nous exposer les enjeux du film, mais mal jaugée, cette confusion noie vite le spectateur. Plusieurs axes narratifs en montage alterné se font face dans cette introduction, et comme on ne sait pas encore qui est qui, le jeu de proportions et de durées qui s’installe échoue à nous faire comprendre que ces éléments vont converger. Un tel procédé hérité des thrillers fonctionne parfaitement… dans les thrillers. Même si la musique instaure un mystère, le montage alterné fait son office dans un contexte qui présente un minimum d’urgence. Les personnages se hâtent, mais la mise en scène et le montage louvoient plus que nécessaire, que ce soit dans la lenteur d’exécution ou dans cet arrêt inopiné à la fontaine durant lequel le paysan voit la femme pour la première fois. Le paysan passe alors pour être un personnage principal du film quand il n’est en fait que secondaire (voire anecdotique). Par la suite, je veux bien que la femme en question ait des yeux charmants, mais n’est-ce pas un peu hors sujet de raconter que le paysan se suicide ? Soit le paysan occupe trop de place dès le début, soit il a comme fonction de stigmatiser la beauté de la femme du maître, faisant de ce fardeau un poison pour qui se laisse séduire. Produire un pendant « naïf » au véritable amant, soit, encore faudrait-il ne pas se limiter à une seule occurrence : au lieu de n’être qu’un homme parmi d’autres pour signifier le fatalisme systématique de la fable, le paysan comme unique alternative donne l’impression de s’inviter à la fête sans que sa présence soit en réalité si indispensable…
Mes réserves concernent également quelques points de mise en scène. La singularité présente l’avantage de l’originalité et… le désavantage de s’établir en dehors des codes habituels. La musique et la lenteur relative du film apportent un cachet étonnant et baroque, entre Mort à Venise (la même année) et un épisode d’Alfred Hitchcock présente. Et comme pour les détours incompréhensibles du récit, certains plans m’interrogent. Je me suis souvent demandé au visionnage si je n’avais pas échappé à un détail ou si tel ou tel plan ne contenait pas une information (forcément symbolique) capable d’éclairer l’histoire ou de lui donner une plus grande logique.
J’ai vu un commentaire sur le film évoquer une comparaison avec le cinéma de Satyajit Ray, c’est vrai que l’on retrouve l’atmosphère (de conte) du cinéaste bengali, mais Ray savait aussi parfois embrumer le spectateur (en tout cas occidental, ignorant à certains égards aux savoirs ou aux symboles de la culture qu’il découvre). Le climat joue également forcément beaucoup, même si l’été arménien me semble beaucoup plus rappeler la disette (jusqu’aux couleurs) baignée de soleil du Uski Roti de Mani Kaul que la chaleur humide de Ray.
Je garde le meilleur pour la fin (parce que ce que je présente comme des singularités offre un certain intérêt au film). En plus des éléments sonores et surtout musicaux, Arman Manaryan propose quelques surimpressions (presque toutes proposées dans la « garçonnière » de madame) d’une rare beauté. La direction d’acteurs n’est peut-être pas optimale à ce moment-là, mais le procédé ravit les yeux. Je garde cette comparaison parce qu’elle traduit assez bien ce que j’ai ressenti pendant le film : un mix entre Mort à Venise et un épisode d’Alfred Hitchcock présente.
La Source d’Heghnar, Arman Manaryan 1971 Heghnar aghbyur / Heghnar Spring |Armenfilm
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant
Ou saisissez un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel