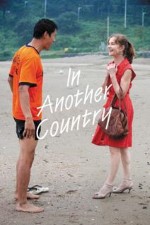Une sage histoire

Un jour avec, un jour sans
Titre original : Jigeumeun matgo geuttaeneun tteullida / 지금은맞고그때는틀리다
Année : 2015
Réalisation : Hong Sang-soo
Avec : Jeong Jae-yeong, Kim Min-hee, Choi Hwa-Jeong, Seo Young-hwa, Yoon Yeo-jeong, Yoo Joon-sang, Go Ah-seong, Gi Ju-bong
Un de mes préférés, assurément. Hong Sang-soo s’amuse une nouvelle fois avec son récit en le découpant ici à la manière d’Eustache pour Une sale histoire. Une relation s’installe entre un cinéaste venu trop tôt à une conférence qu’il devra donner le lendemain et une jeune peintre : ils passent la journée ensemble, puis prennent un verre et terminent la soirée chez une amie de la peintre.
Jusque-là, c’est déjà tout à fait charmant : comme d’habitude, il est plus facile d’adhérer quand les acteurs sont formidables. Et Hong Sang-soo semble même avoir une idée de génie pour les diriger : si les scènes de beuveries sont habituelles chez lui, mais pourquoi diable n’avait-il jamais eu l’idée de leur demander pour plus de crédibilité… de s’enivrer réellement ? Je plaisante, mais c’est en tout cas ce qu’on se dit quand on voit les deux acteurs se faire face, multiplier les verres et montrer autant de spontanéité, libérés de toute retenue.
Et puis, au bout d’une heure, on reprend tout et on recommence. Le jeu habituel des sept erreurs, l’univers quantique du cinéaste qui aime tant explorer les possibilités narratives, les occasions manquées, les récits alternatifs… Avec une idée somme toute assez simple, mais aussi audacieuse comme dirait son propre personnage. On remarque dans les situations quelques différences, on se demande même parfois si on n’a pas été attentifs la première fois ou si ce qu’on remarque participe à ces éléments modifiés par rapport à la première version. Comme dans le Eustache (qui était peut-être même encore plus radical dans son dispositif), l’aller-retour permanent entre les deux parties (via notre mémoire) force l’attention, pousse parfois à l’ironie, voire à une certaine forme de philosophie parce qu’on se sait être nous-mêmes placés tous les jours dans des situations capables d’influer sur notre environnement, notre rapport aux autres et notre propre destin. Les deux destins proposés ici ne sont pas radicalement opposés, mais étrangement, c’est peut-être celui qu’on pourrait craindre tourner le plus mal qui s’avère le plus positif pour les deux personnages.
Dans la forme, c’est peut-être encore plus étrange. En tant que spectateur, ces séquences d’ivresse m’étaient apparues bien plus crédibles lors de la première partie : au contraire de la première, les acteurs ne me paraissaient pas réellement ivres dans la seconde version. Était-ce l’effet d’une certaine lassitude de la répétition, la fin d’un effet de surprise ? Ou le cinéaste s’est-il amusé à créer de telles différences ? On pourrait s’amuser, nous, spectateurs, à imaginer, soit que les séquences aient été tournées à des jours d’intervalle et que les acteurs aient refusé de s’enivrer autant comme la première fois, soit (et ce serait plus crédible encore) que le cinéaste ait multiplié les prises en improvisation dirigée le même jour de tournage tout en leur demandant de continuer de boire. Il aurait ensuite placé au montage la séquence tournée plus tardivement (avec des acteurs ivres) avant la séquence tourné plus tôt (avec des acteurs encore relativement sobres). On peut le remarquer d’ailleurs, et sauf erreur de ma part, dans la première partie, les acteurs ont deux bouteilles vides de soju face à eux et en sont à la troisième, tandis que dans la seconde partie, ils n’entament que la première, les deux autres bouteilles étant sur la table mais pleines. C’est un classique chez les acteurs : si, à la première prise, on peut espérer plus de spontanéité (surtout en improvisation dirigée), à force de répéter, on gagne en idées nouvelles, on perd en spontanéité… jusqu’à ce que la fatigue se fasse sentir et qu’on lâche prise. On ne saura jamais, et c’est tant mieux. L’intérêt de tels procédés ou astuces, au-delà du récit et de la comparaison, c’est bien de susciter de telles questions sur le film sans chercher à y répondre. Comme le tour d’un magicien, celui d’un cinéaste (et de son équipe) doit rester impénétrable…


Jeu des 7 erreurs : Un jour après trois heures d’impro (et d’alcool) / Un jour après une heure d’impro (et pas pour autant sans alcool)
Bien sûr, tout au long du film, on peut aussi sourire de l’autodérision du cinéaste : ça ne m’arrive pas toujours, parler des cinéastes ou des créateurs à l’écran pouvant parfois m’agacer. Mais la pilule passe toujours mieux avec des acteurs qui savent mieux s’y prendre que d’autres. Il faut parfois multiplier les prises pour trouver la bonne affinité entre les acteurs ; parfois, ce sont les acteurs qu’il faut multiplier pour trouver la bonne osmose avec une histoire ou un public. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu ces acteurs dans d’autres films du réalisateur jusqu’ici (mais ma mémoire et ma mauvaise physionomie jouent souvent avec moi leur propre magie avec leurs mauvais “tours”), ils sont parfaits, et on retrouve quelques-uns des chouchous du cinéaste dans des seconds rôles, faisant presque office pour certains de gardiens du temple (presque littéralement ici).
(Je suis la filmographie relativement dans l’ordre : c’est donc le premier film du cinéaste que je vois avec sa future égérie, Kim Min-hee. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle colle parfaitement au ton du cinéaste. On peut relativement bien imaginer aussi que Hong Sang-soo se soit laissé largement influencer par elle. C’est indéniable, sa présence a eu du bon dans l’approche du cinéaste, et c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour lui avec cette rencontre — mais j’évoque cela ailleurs.)
Je pourrais, bien sûr, m’énerver encore une fois en voyant le cinéaste être toujours aussi attiré par les jolies filles, mais au moins ici, il ne joue pas les Woody Allen et n’impose pas à ses actrices une certaine forme de gérontophilie malaisante : le personnage du cinéaste est certes plus âgé que la peintre, mais cela reste encore raisonnable, et surtout, ça doit parler à mon côté prude parce qu’au fond, l’honneur et la morale sont saufs. Des mots d’amour, un baiser sur la joue, et puis s’en va.
C’est tellement plus beau comme ça, Sang-soo. Ne fais pas ton Jean-Claude Dusse, ne force pas, ne conclus pas (je parle de films). Parce que si tu nous proposes deux versions différentes d’une même journée, on se charge tout seuls des mille autres versions possibles où les personnages comme dans Un jour sans fin s’y reprennent chaque fois de façons différentes pour explorer les possibilités, même les plus graveleuses. Après tout, c’est un réflexe que le spectateur possède déjà et que tu ne fais qu’invoquer ou exploiter à travers ton film : « Et si l’on avait agi autrement ? ».
On se pose, et on “pause”. Retour en arrière. « Et si ». Invoquer seulement les possibles, ne suggérer que de petites différences comme dans un jeu de sept erreurs, ce sera toujours mieux. Car Jean-Claude Dusse, lui, il explorerait la possibilité unique qui lui serait offerte de conclure, et il se l’imaginerait écrite par Marc Levy. Tu m’ennuies souvent, Sang-soo, mais je te reconnais au moins le fait de ne jamais tomber dans ces excès, ces “forçages”. Attention à toi cependant : j’espère que tu explores tes fantasmes à travers tes films, que tu te sers d’eux pour produire, créer, mais que tu ne franchis jamais la ligne jaune. Je t’ai à l’œil, Jean-Claude : garde ta chemise.
Un jour avec, un jour sans, Hong Sang-soo 2015 Jigeumeun matgo geuttaeneun tteullida / 지금은맞고그때는틀리다 | Jeonwonsa Film
Sur La Saveur des goûts amers :
Listes sur IMDb :
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel