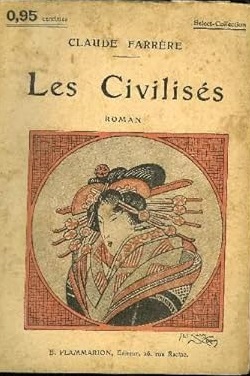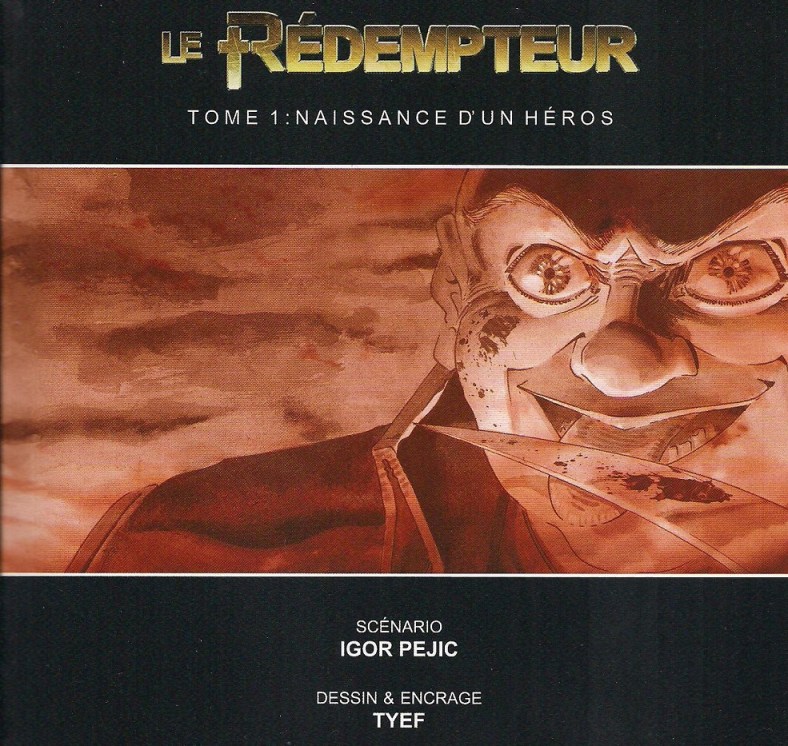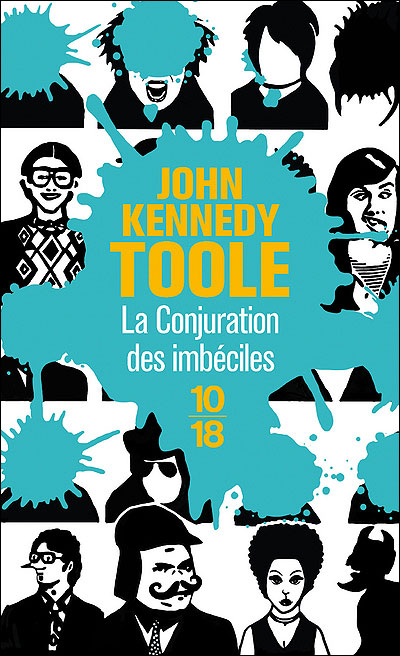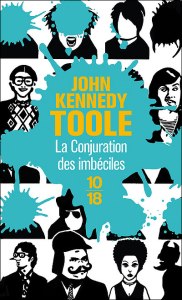Il faut reconnaître le talent de John Kennedy Toole à décrire assez habilement certaines situations, à faire de l’esprit, bref, à se la ramener s’il n’était question que de juger de sa capacité à écrire. C’est assez réjouissant à lire, après tout, aussi étrange que cela puisse paraître, j’y ai retrouvé par certains aspects les qualités d’écriture d’un Céline ou de l’autre JK (on ne rit pas)… Rowling.
Là où j’ai plus de mal, c’est dans la structure et la finalité du tout (la géométrie et la théologie comme dirait l’autre). Si on peut penser, ou espérer, que ce génie caustique puisse servir à démolir ou dénoncer la bêtise humaine, ce n’est pas seulement à travers quelques répliques bien tournées ou des situations révélatrices qu’on pourrait y parvenir : il faut un but à tout ça. Or de but, il n’y en a pas. JK Toole lance les situations comme elles viennent, dépeint les trajectoires de plusieurs personnages typiques de sa ville, à la manière presque d’un Robert Altman, façon chronique dépaysante et absurde, sauf qu’il semble amorcer un récit initiatique (inspiré ou pas par Cervantès), et on quitte alors la chronique pour une quête décousue, plutôt répétitive voire immobile, engourdie, ou qui devient même souvent carrément vociférante, gesticulatrice, pour en cacher l’errance véritable. Au point qu’on pourrait se demander si JK Toole ne tombe pas dans ce qu’il semble dénoncer à travers son personnage, le manque, donc, de théologie et de géométrie. Tout cela est un peu trop foutraque pour mener quelque part. On l’adapterait au cinéma qu’on serait proche des comédies lourdingues que Ignatius exècre, ou, au hasard, de la série Roseanne avec John Goodman : de l’insolence, pour se défouler un peu, et tout redevient dans l’ordre. Et encore, il y a sans doute plus de géométrie chez Doris Day que chez JK Toole. Parce qu’on compare parfois Ignatius à Don Quichotte, j’y verrai plutôt une apparentée avec Matamore. Ignatius en présente les mêmes limites. Matamore est drôle quand il se vante, quand il fait le récit de ses exploits, quand il délire et que ça reste du vent. Mais qu’on le voit alors à l’œuvre (et ce serait difficile) et on serait obligé de le prendre au sérieux parce que si Don Quichotte ne fait pas de mal à une mouche, Matamore (et donc Ignatius) est bien capable, peut-être pas de bousculer les astres comme il le prétend, mais, du pire… Ignatius est drôle en écrivaillon raté et prétentieux dans sa chambre à vomir sur le monde ; il l’est encore quand il se chamaille et braille sur sa mère, parce que la violence ne peut être que feinte quand elle passe, encore, qu’à travers la langue (on reste dans l’humour screwball, où la suggestion fait tout, où l’opposition de style fait mouche parce qu’Ignatius et sa mère, c’est drôle comme une bonne comédie du remariage entre mère et fils) ; il l’est encore, drôle, en emmerdeur professionnel, en employé médiocre (surtout en vendeur de hot dog), en spectateur de show TV ou de cinéma outré de ce qu’il voit ; et il l’est enfin quand il correspond avec sa libérale dulcinée (même principe d’oppositions extrêmes). Car Ignatius est un fat, dans le sens théologique du terme (non géométrique), et c’est là seulement où il fascine et où on peut garder de la sympathie pour lui. Que lui, l’hippopotame, dise pouvoir foutre un tutu et faire la leçon à des petits rats, et on rit ; mais on rira moins s’il met à exécution ses prétentions, comme un gag qui s’éternise ou se répète. Là où ça devient franchement lourd et moisi donc c’est quand les prétentions viennent à se faire aussi grosses que le prétentieux : Ignatius en Spartacus ou en Fletcher Christian ça ne le fait déjà plus du tout.
Parce que si Don Quichotte nous amuse dans ses périples picaresques, on le suit avec plaisir, ou avec bienveillance, parce qu’on le sait à la fois fragile et plein de bonnes volontés : on rira de ses malheurs, de sa crédulité, de sa douce folie… Ignatius, c’est tout le contraire, c’est un fou, mais un fou furieux ; quand son agressivité se limite à un babillage précieux et savant, on s’amuse de l’écart entre ce qu’il prétendrait faire et, ce qu’on sait, n’arrivera jamais : c’est Matamore mettant à ses genoux les Titans. Mais s’il s’arme d’un sabre en plastique et mène des révolutions, ça en devient con et superficiel. Parce que tout à coup ce n’est plus Ignatius qui part à l’abordage des cons, c’est JK Toole, et ce faisant, se ramasse comme son personnage. La prétention, pas l’action. Là où on entre en empathie avec Don Quichotte, à travers sa fragilité, on ne peut pas en faire autant avec un Ignatius qui, lui, s’en prendrait sans honte à la veuve et l’orphelin. Si certaines diatribes peuvent amuser parce qu’elles ont quelque chose de juste, ou montrent à quel point, comme Don Quichotte, il est à côté de la plaque, d’autres, quand elles ne servent plus qu’à fuir ses responsabilités sont carrément lourdingues s’il n’y prend jamais conscience au fil du récit et ne se contentera jusqu’à la fin qu’à fuir et à médire le monde. S’il parlait plus et agissait moins, voilà qui ce qui en ferait un personnage redoutable, un monstre d’aigreur et d’intelligence qu’on se prendrait à aimer, et à défendre. Or, trop souvent, Ignatius se fait lourd. Parce que lui ne se bat pas contre des moulins.
Le récit s’enclenche avec un accident de la route après quoi le brave homme devra aider sa mère à rembourser les dégâts : il lui fait trouver du travail, lui, le génie oisif et incompris. On aurait pu penser qu’il y aurait alors une évolution, presque initiatique, chez le personnage, que cet accident devienne en quelque sorte la faute initiatrice d’un mouvement, l’événement le poussant dans sa quête, celle qui lui ferait prendre conscience de ses propres torts, de ses erreurs… Le génie, il aurait été là. En plus d’être brillant et drôle, il aurait fini par être réellement touchant en trouvant sa voie. En ne voulant qu’être drôle, et surtout en s’agitant comme un zouave et en retournant toute la ville derrière son passage, on ne voit plus que des gesticulations et des braillements. C’est l’affreux Bibendum de SOS Fantômes. Si les cinquante premières pages sont longues à se mettre en place, il reste encore une autre cinquantaine avant la fin qui est un supplice. Toole aurait gagné, au moins, à raconter certains de ces méfaits (par Ignatius ou par d’autres) au lieu de les décrire. On serait resté dans ce qui fait la saveur du roman, le récit, l’évocation. Certes il n’aurait été plus seulement question de prétention parce que notre monstre matamoresque se serait mis en branle, mais justement, ça aurait été un moyen, à nouveau, de travestir la “réalité” pour en grossir les traits, les exagérer, à travers la langue, le récit, le mensonge… On aurait alors recentré le roman sur la perception excentrique du monde que se fait Ignatius, et sa folie aurait été supportable, car inoffensive.
En réalité on serait presque en droit de nous demander si le véritable héros du roman ne serait pas M Levy dont la trajectoire prend un sens qui me semble moins futile et lâche que celle d’Ignatius. Si l’odieux gros lard finit comme il a commencé, c’est-à-dire à se foutre de la gueule du monde, à chercher à échapper à ses responsabilités, et tout ça laissant en plus l’impression de finir en happy end sur lequel le bonhomme serait le premier à vomir (si on est conciliant on pourrait y voir une fin digne du Lauréat), M Levy, lui, non seulement fait preuve de compréhension à son égard (c’est le véritable philosophe de l’affaire), mais en plus il reprend foi en son travail, semblant vouloir se détourner de son confort oisif pour une ambition juste et mesurée à mille lieues de celles de l’ignoble Ignatius ; et cela non pas dans un détour épilogique qui pourrait laisser penser que l’entrepreneur désintéressé des affaires dont il a hérité puisse tout à coup devenir le chef d’entreprise modèle qu’il n’a jamais été, mais bien parce que sa réussite et son désir de reprendre les affaires en main ne seraient rien d’autre qu’un doigt d’honneur adressé à sa femme qui n’attend qu’une chose, qu’il se plante. Qu’il y parvienne, c’est de la péripétie accessoire, comme toutes celles que nous propose Toole dans toutes leurs largeurs : parce que ce sont bien les prétentions, les volutes de fumée, qui importent ; les mettre tout à coup en scène, c’est patauger dans ses contradictions et se vautrer dans la vulgarité. Le voilà donc l’honnête rebelle de cette histoire. Celui qui finit par affronter les emmerdeurs en face. Ignatius, tout brillant qu’il est, est, et restera, l’emmerdeur qui emmerde le monde merdique. C’est une usine à gaz d’idées savoureuses et replètes : ça tourbillonne, ça tourbillonne, et ça finit coincé dans un engorgement pylorique pour ne jamais prendre forme et consistance… Il ne se sert de sa prétendue intelligence que pour manipuler son monde et n’apprend donc rien de ses expériences : qu’il manipule les foules, les passants, ses employeurs, sa mère, il finira dans la même logique sans avoir changé d’un gramme en se servant opportunément de sa donzelle libérale pour s’échapper du merdier qui l’attend. Odieux envers sa mère, manipulant sa petite amie, rechignant à affronter ses responsabilités, Ignatius reste un Ubu inflexible incapable d’apprendre de ses expériences, un Matamore dont on ne peut plus rire, bref, un enculé, et c’est probablement bien la seule raison théologique qui le tirbouchonne tant à l’intérieur.
Reste l’écriture, le génie épars qui occasionne quelques instants de grâce linguistique. Et là, même si on peut regretter qu’à la traduction, il n’en sorte qu’une transcription évasive, notamment en transposant les différents accents de la Nouvelle-Orléans dans un français parigot certes efficace mais forcément pâlot, on ne peut que louer l’essentiel qui me semble-t-il (du peu de ce que j’en ai vérifié) reste une traduction quasi littérale, respectant l’habileté de l’auteur et de son personnage principal à inventer des tournures souvent épithétiques ou périphrastiques, autrement dit en jargonnant pour jouer des contrastes, et divertir le lecteur en l’incitant à comprendre les allusions ou les circonvolutions, rarement finaudes, mais follement excessives, et c’est bien là l’intérêt de la chose. Mais comme tout est mesure en art, il faut parfois aussi doser ses propres limites… ou du moins savoir les placer. Si le monde manque de théologie et de géométrie selon Ignatius, il semblerait bien aussi que ce soit tout le problème de l’auteur. Finalement, le suicide de l’homme posthumisera l’auteur en donnant un sens à ce qui en était dépourvu… Là où Toole se serait perdu en gesticulations habiles mais vaines pour vendre, et confirmer son talent plein de promesses, ne reste que l’évocation d’un génie que le monde n’aurait su entendre… JK Toole n’a pas eu comme son personnage à mettre à exécution ses pataudes prétentions, on les imagine à sa place. La tragi-comédie qu’il a été incapable de construire dans son roman, il y a mis un terme, comme Ignatius, en s’embarquant dans une voiture. Il ne savait pas plus que lui où il allait ; nous, on sait. Les artistes, c’est comme les mouches ; on ne les apprécie jamais autant que quand ils tombent. Encore faut-il qu’il reste quelqu’un pour lire leur épitaphe. Les éloges funèbres, prétendent toujours, travestissent la réalité, voilà tout ce qu’on pourra jamais trouver de plus théologique et de géométrique en ce monde.
BzzzzZZzzzzzzz
(Je suis une mouche. Non, ce n’est pas ça.)