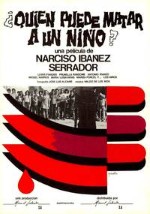Amusant de voir à quel point ce film se fait défoncer. Je dois être un zombie à ma manière pour l’apprécier plus que d’autres. Je suis loin d’être un amateur de films d’horreur, et là est sans doute l’astuce : World War Z est un blockbuster plutôt grand public centré sur une catastrophe épidémique fulgurante et mondiale.
Alors que traditionnellement dans les films d’horreur, le spectateur titille son propre rapport à la mort, s’amuse jusqu’au grotesque de l’image de son cadavre livré aux charognards ou aux esprits maléfiques, incapable de trouver la paix éternelle, le tout dans un grand carnaval cathartique censé le laver de ses peurs primaires, rien de ce rapport à la mort un peu masochiste dans World War Z : les zombies n’y sont — réellement — pas les bienvenus. L’humour est toujours périphérique (le propre des hommes et de leur bêtise plus que du ridicule des monstres claudiquant la bouche ouverte). Cet humour est plus souvent absurde que grotesque, et quand il est question de montrer individuellement des morts-vivants, l’idée semble moins de faire peur ou de nous dégoûter en nous rappelant qu’avant de retourner à la poussière, un corps est un gros sac de tripes, que d’opposer à nos héros des ennemis animés peut-être par un agent infection, un virus sans doute, qui n’ont plus aucun rapport avec les morts-vivants tels qu’on se les représente dans les premières histoires de zombies (avec une forte imprégnation des mythes vaudous).
Il faut reconnaître que pour un film de zombies, on échappe à certains codes du genre qui m’ont toujours dégoûté : peu de sang, pas de tripes à l’air prêtes à être dévorées, et quand on voit en gros plan les morts-vivants, on voit clairement qu’il s’agit de mastoc (le plastique salit moins que le maquillage). Des pions donc, une armée de cadavres, certes, mais bien impersonnels. Il faut noter par exemple qu’un des ressorts dramatiques habituels du film de zombies, c’est de voir surgir un personnage secondaire changer de bord si on peut dire et s’en prendre à ses anciens compagnons. On ne voit ça ici que brièvement qu’avec des seconds couteaux (certains ont pu se plaindre d’ailleurs de voir l’indifférence des survivants face au plus marquant d’entre eux : le père du jeune hispanique qui accompagnera la famille de notre héros tout au long du film).
Plus important encore, et c’est un des points qui, sans doute pour des raisons personnelles, m’a réellement foutu les chocottes, c’est la vitesse de déplacement des zombies. Traditionnellement, les morts-vivants avancent les bras en avant telle la créature de Frankenstein surprise en pleine crise de somnambulisme. Ici, et sans faire référence à un précédent film avec Brad Pitt commenté, les créatures sont pleines de furie et avancent par vagues. La vitesse de propagation du virus en est d’autant plus rapide, d’autant plus qu’il faut moins de dix secondes pour qu’une personne infectée chasse la vermine humaine à son tour. Ce qui est effrayant, c’est l’ampleur de la contamination, son extrême violence et la vitesse à laquelle elle se propage. Comme si l’ombre effrayante et morbide qui l’accompagnait était inéluctable.
Je parle de raisons personnelles. Je n’ai vraiment aucune appétence particulière pour les films de zombies. La vague critique consumérisme ou les séquences de cloisonnement que les films produisent peuvent temporairement éveiller mon intérêt, mais globalement, faire joujou avec des pots d’hémoglobine ou des lambeaux de peau putrides, c’est loin d’être mon truc. Là pourtant, il y a quelque chose dans ces séquences de foule qui me fascine. Il faut reconnaître que l’aide massive des effets spéciaux doit y faire : la vitesse semble par moments accélérée, les chocs sont extrêmement violents, donnant l’impression que des morceaux de chair sans vie s’animent tout à coup, mécaniquement, pour croquer une foule apeurée ayant peu de chance de survie dans de tels espaces à ciel ouvert (la dernière partie dans un centre de l’OMS me semble à ce sens plus traditionnel, parce qu’on joue plus sur la peur et le cloisonnement que sur la peur des grands espaces encombrés et des foules grouillantes — encore — de vie). Ce qui fascine tout autant, c’est que les zombies ne s’arrêtent pas pour savourer la chair fraîche comme on le voit dans la plupart des films : c’est une vague, ou un voile, de mort qui s’étend brutalement sur les vivants, qui une fois contaminés grossissent le rang des morts-vivants pour contaminer les autres. L’impression qui en ressort, c’est que les chances d’y échapper sont quasi nulles, un peu comme si on se retrouvait pris au piège sous une avalanche ou un tsunami. Pour moi qui apprécie assez peu les foules et les grands espaces dans la vie, l’effet est immédiat. Je n’ai pas pour autant les pétoches, on ne va pas exagérer, mais ces images de marées humaines déferlant dans des ruelles ou des places en panique qui de loin donnent l’impression d’une tache d’encre qui ne finit plus de s’étendre, oui, ça me fascine. Et si certains peuvent être fascinés, et trouver même très joli de voir des tripes à l’air lancer des giclées rouges, jaunes et vertes dans le champ, ces images-là, moi, m’inspire surtout du dégoût.
Esthétiquement parlant, oui, je trouve ça beau. C’est comme une chorégraphie de corps faussement désynchronisés. Il y a même probablement une symbolique amusante qui se cache derrière cette foule qui fuit, qui crie, et qui retourne sa veste en moins de deux : comme une république en marche qui phagocyte tout sur son passage : ni mort, ni vivant, mais les deux à la fois. Le « en même temps » rapporté à la psychologie des foules. Le zombie des origines imprégné de vaudou et le zombie des Trente Glorieuses se retournant dans sa tombe pour consommer la dernière ressource disponible sur terre, la chair humaine : le zombie de ce World War Z serait ainsi un mutant capable de courir plus vite que son concurrent encore bien vivant pour se ruer à une promotion de pots Nutella.
À moins que cette fascination soit une réminiscence des premières images de mon enfance qui m’avaient traumatisé, celles du clip de Thriller, et quelque chose qui se rapproche de l’armée de squelettes dans Jason et les Argonautes… En ce sens, j’ai très vite été convaincu par le film : même si c’est assez peu crédible (à la vitesse de propagation du « virus », il n’y aurait probablement besoin que d’un seul foyer pour infecter la planète entière en moins d’une semaine : les actualités parleraient du chaos dans la région où ça se passe, et les autorités prendraient vite des mesures contraignantes pour isoler une large zone autour de ce foyer d’origine), le changement est radical. L’idée de placer dès le départ la famille dans un lieu à la fois confiné comme une avenue congestionnée de Philadelphie, grouillant de monde, crée de suite une menace d’une ampleur inouïe. L’horreur, elle est moins dans l’image individuelle qu’un zombie pourrait offrir aux yeux de celui qui le regarde effrayé ; elle est dans la brutalité et la vitesse à laquelle cette menace extrême se répand. On est proche des « grandes menaces sur la ville » depuis longtemps illustrées dans les films de seconde partie de soirée : des films de monstres comme Godzilla ou King Kong, des films d’invasion extraterrestre comme La Guerre des mondes, des péplums catastropho-macistes, ou encore des films de super-héros qui dernièrement ont pu être crédibles dans ce registre — les destructions massives n’impliquant plus seulement des « objets » mais des personnages à part entière — grâce aux effets spéciaux numériques. Ce sont ces mêmes effets spéciaux qui rendent possible dans ce film la vitesse de déplacement des zombies. Un zombie à forme olympique ! Captain Zombie !…

Un autre aspect du film qui me fascine, et m’amuse, c’est ce qui est précisément suggéré par le titre, à savoir une guerre totale contre un virus (ou les zombies ainsi parasités). On a commencé, de ce que j’en sais, à faire des zombies qui s’attaquaient dans les années 60 à des individus, c’était la peur du mal tapi dans l’ombre. Dans les années 70, le zombie est devenu le consommateur asservi à son produit, et de la sphère privée, on passait à celle de la communauté (celle qui se retrouve au supermarché du coin). Et puis dans les années 2000, au milieu de quelques parodies ou films mutants, grâce aux moyens mis par les studios (les films de soirées bis passant en première partie de soirée), on est passé à une sphère plus large, en incorporant à l’histoire des implications militaires et politiques (en perdant aussi tout l’esprit et le second degré des films de la génération précédente) ; les films de zombie sont ainsi devenus des films apocalyptiques. C’est bien ça ?… L’apocalypse, ça suggère que la guerre est sur le point d’être perdue ou qu’elle est en tout cas mal engagée : des individus se retrouvent isolés les uns des autres, des groupes se constituent pour lutter contre des hordes de zombies, et globalement aucune autorité nationale ou supranationale n’est encore en place ou en mesure de lutter efficacement contre « la menace ». On passe donc ici encore à l’échelon supérieur : on quitte plus ou moins la sphère privée (j’aurais préféré perso qu’on le fasse totalement en évitant de devoir passer par les personnages familiaux : une vaine tentative sans doute de faire grand public à la Spielberg, mais c’est plus irritant qu’autre chose) pour se retrouver au niveau le plus élevé possible : et si l’armée est bien présente, il faut noter pour une fois que le plus haut niveau de responsabilité évoqué, c’est celui de l’Organisation des Nations Unies, pas… la Maison blanche. On semble même s’amuser dans le récit à dézinguer certains codes du genre (celui du film à gros budget impliquant cette « fin du monde », beaucoup plus que le simple film de zombies, oui) : le Président ? On l’apprend rapidement, il est mort, mais on fait avec (aucun drapeau en berne, aucune réplique patriotique : on s’en fout, vive l’altermondialisme zombie). Le scientifique fraîchement sorti d’Harvard censé résoudre le mystère du patient zéro ? Mort sur le coup en marchant sur une peau de banane (on appelle ça un contrat « Janet Leigh » : on croit à la lecture du scénario qu’on va avoir la part belle dans l’histoire, et on se fait zigouiller bêtement à la séquence suivante). L’artillerie lourde ? N’y pensez pas, les zombies sont attirés par le bruit. Et on voyage donc. Ici on ne change pas une menace qui gagne : elle vient toujours de l’extérieur. Et oui ! Parce qu’il y a un petit côté Tintin, sauveur du monde, James Bond contre l’apocalypse, qui m’amuse beaucoup.

Ensuite, si le film possède ses petites et grosses incohérences, certains détails sont particulièrement bien trouvés, parfois même savoureux. L’idée de se retrouver à Jérusalem ceinturée par un gros mur, ça pourrait être politiquement incorrect (je ne pense pas que Trump en était déjà à évoquer un mur le long de la frontière mexicaine au moment de la sortie du film), mais en fait ça tient assez bien la route. L’État juif ainsi enclavé est même paradoxalement montré sous un angle positif parce que comme s’en étonne le personnage de Brad Pitt, on y laisse passer de nombreux non infectés. Malheureusement, parmi eux, certains (d’accord, ce sont forcément des musulmans) sont si enthousiastes à l’idée de sauver leur peau qu’ils commencent à entonner des chants… Et d’un coup, on se croirait à Jéricho. L’allusion est peut-être grossière, mais elle m’a fait rire. Le reste est spectaculaire et ferait presque penser au siège de je ne sais plus quelle ville dans Le Seigneur des anneaux assaillie par une armée de trolls et autres forces zombiesques… Rien ne se déroule comme prévu, et notre tintin casque bleu s’invite dans un appareil biélorusse. On continue de casser les clichés habituels du genre, et le choix d’un équipage biélorusse n’est pas anodin : le pays est souvent présenté comme possédant un des régimes les plus répressifs d’Europe, et des sanctions sont effectives contre lui au moment de la sortie du film. Or, on prend bien soin dans le film de ne pas les montrer comme des opposants ou des crétins de circonstance ; au contraire, l’équipage est coopératif et toutes les nationalités sont représentées parmi les passagers (même un zombie, c’est dire l’hospitalité). Des petits détails qui agaceraient assurément s’ils allaient dans le sens inverse : c’est un reproche souvent adressé à Hollywood, il faut donc noter l’effort à ce niveau.

La dernière réussite du film à mon sens, c’est l’astuce élaborée pour trouver une issue à tout ce chaos zombio-épidémio-logique. La première astuce narrative du film était de faire des zombies des monstres attirés par le bruit (ce qui oblige à pas mal de prudence et interdit des méthodes à la Rambo) ; la seconde, flairée par notre pittoyable enquêteur de l’ONU : les zombies ne s’attaquent qu’à des individus sains. Un paradoxe, mais l’idée de se retrouver immunisé contre le mal ultime (la mort qui vous étouffe et fait de vous un de ses agents en un clin d’œil), c’est à la fois bien trouvé et, visuellement, follement spectaculaire. Et moi, j’adore les petites astuces narratives dans les films de série B…
Voilà, manifestement je n’ai pas vu le même film que bon nombre de spectateurs. À partir du moment où très vite j’ai été fasciné par ces hordes de zombies déferlant dans une mégapole américaine, les incohérences et les facilités qui suivaient, j’étais prêt à les accepter. Phénomène plus étonnant en revanche, Brad Pitt m’a même semblé sympathique. Le contraire m’aurait inévitablement gâché le plaisir. Il faut croire que ça a du bon d’arrêter de perpétrer des crimes de guerre. Quand il est là, le plaisir, pourquoi dandiner des couches. Courez, zombies ! S’il devait n’en rester qu’un à sauver ce film, je serais celui-là !
Z