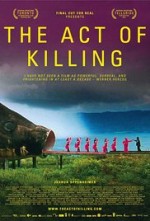Samsara est une expérience non verbale ? Eh ben, ce commentaire aussi. Façon diarrhée taillée à la serpe, dans l’amour et la contemplation, malaxée entre les mains de Shiva, contrepétrie au fournil par mes soins.
Désolé de ne pas y mettre les formes. I had a dream. À la vue de cet objet filmique, j’ai rêvé que ma cervelle se répandait tout entière dans une pluie de confettis et qu’un mille-pattes en avait enregistré des bribes. Un âne aux abois n’y retrouverait pas son anus.
C’est beau et vulgaire, donc. Je ne voudrais pas dépareiller avec le film.
Samsara, c’est quoi ? D’abord une épouvantable musique de trou de balle. L’impression d’avoir un micro planqué au plus près de la cuvette d’un Crésus constipé. Les images ne sont là que pour faire patienter sa peine comme on comble sa trouille du marron qui ne vient pas avec les images glacées d’un Geo. C’est aussi… la beauté qui soulage et lubrifie les voies basses avant le grand plouf… Ayant déjà dû me farcir toute la collection, entre Koyunuctaboul, Barakaca, Chronus ou Ashes and Snow, j’ai les intestins lavés de près comme si Hercule y avait mis la langue, je ne peux donc juger des vertus laxatives de ce nouveau morceau et fais confiance à ceux qui se le garderaient au cul. En attendant, il me faut bien évaluer cet opus, la tirelire à sec. Mais le mors aux dents.
Mon poilu, le montage au cinéma est toujours discursif, signifiant, narratif. Un plan répond presque toujours, même sans intention de le faire, à celui qui précède. C’est à la fois la force et la faiblesse du cinéma. Parce qu’à la manière des tireurs de tarot, les signes sont là, reste à celui à qui ils sont destinés de les interpréter. Autant lever les yeux au ciel pour y voir des animaux ou des visages connus dans les nuages. Au début du film, ça ne fait même pas semblant, on cherche désespérément le lien (ou plutôt, on a la flemme de chercher), on se laisse bercer par la bêtise ronronnante du montage en espérant que tout ça défèque un jour à quelque chose. Seulement, on l’aura compris, encore plus qu’avec les autres, rouler à vide n’aide pas à se laisser envoûter par le popo du film. Et à défaut de pouvoir laxer… ça lasse.


Plein de bonnes intentions, faute de mieux, je fais un créneau sur mon trône et cale ma lassitude hâtive au fond des talons. Mais rien n’y fait, quand ça fait tout un cinéma d’un catalogue de posters épars, pourquoi chercher encore à se tapisser les yeux avec de nouvelles images « qui en jettent » quand mes larmes ont déjà fait couler de leur orbite, et en un clin d’œil, toutes les affiches des films précédents ?
Bon, ça vient ?… Je vais lire le Geo de novembre en attendant.
Combien de fois va-t-il falloir se farcir ce même patchwork d’images insignifiantes, belles ou laides, trempées dans un discours lâche comme la diarrhée du petit Marcel ? Du champ, nos yeux ne verront qu’un folklore chloré, qu’un monde sous cloche agité pour en animer des figures mortes. C’est beau comme un étron pâtissier. Ça scintille après glaçage, ça chatoie comme un manteau d’Arlequin ou comme des jumeaux vairons, on fait mumuse à comparer les images, à opposer le laid au beau, à scruter les assemblages dépareillés, mixtes et cocasses. Bref, ça nous pisse dans le fond de l’œil et ça permet de nous laver la tête des merdes qu’on aurait bien pu, nous, animaux vulgairement intelligents, se foutre derrière les yeux.
Le beau tomisé.
La lumière fume la rétine, cristallise les neurones, et la vérité du beau doit jaillir comme une boule de feu intérieure. Mais surtout, hein, sans direction, sans signification (ça tombe sous le sens). Car une fois cramés, on doit rester la gueule bée devant le miracle du monde, s’agenouiller devant le Beau, et lui offrir, l’échine courbée comme le “s” vadérétrochristique de “vénération”, la preuve de notre parfaite docilité : notre émotion.
Nous voilà oints de lumière — reflet de notre âme servile. Repus de desserts lactés, on se tient au garde-à-vous devant la quenelle de Saint Jean. On se rince l’œil, on pleure, et ce n’est que bonheur, car on s’en lave les mains. On se sèche alors les yeux : ne reste rien d’autre que cette lumière imprimée dans le fond de l’œil, comme une ombre persistante et claire — souvenir incandescent des festins éphémères.
Sans consistance aussi : c’est un chaos de couleurs sans verbe, des images pronominales bariolées de fausses idées auxquelles le spectateur finira bien par y déposer son compte.
L’illusion s’épuise dans sa merveillescence. La tache fantôme qui illuminait autrefois le cul de l’œil flétrit dans un pesant silence. La lumière diffuse laisse place à la raison, et on comprend que le folklore samsaresque est un package vulgaire de cultures, un foisonnement d’images foutraques, un « savoir ancyclopédique », un guichet vers le ravin aux fraises, un portillon à trois verges bandées comme le tabouret traversier donnant accès à ces peep shows qui nous laissent entrevoir le meilleur à l’entrée pour mieux nous plumer à la sortie. Des guirlandes de belles images dégobillées sur le tapis. De l’abondance fuchsia, affriolante et gesticulante comme un boudin encore fumant dans ses entrailles. Vas-y mon frère, sers-nous ta bouillie d’images pompières, ton éructation de couleurs tous azimuts, dans l’âtre fourbu de notre foie. Oui, encore, oui, oui… ! Que de beautés vulgaires ! Queue de la guiche trou de balle !
Et tout finit en urine. Couronné comme il se voit au trône de nos envies.
Non, Samsara n’a rien d’un documentaire, c’est tout Rome en somme. Le coup de l’humanité vue de loin par les yeux du grand néant, de la bouteille à la mer retournée à son expéditeur faute d’adresse, ça marche peut-être une fois quand Carl Sagan fait plaquer la carte d’identité de la Terre sur un disque en or avant de lancer Voyager dans le cosmos. Pas besoin d’y revenir cent fois, avec mille images différentes, comme pour nous dire : « Ah merde, en fait, toutes exhaustives qu’on pensait être les versions précédentes, on y aurait bien vu ça aussi, et pis ça, et ça… ». Le message est connu de tous et nous sommes incapables d’en faire quelque chose. Si on veut rester sur cette voie, ça ne sert à rien d’enfoncer le clou des évidences comme s’il y avait encore quelqu’un à convaincre du contraire. Il faut se mettre à proposer des réponses, à voir plus loin. Le constat a cela de parfaitement ennuyeux, et de pratique, qu’il n’est jamais remis en cause. La question n’est plus là. Du « on est tous beaux, et putain, vous savez qu’on va en crever ? alors mettons tout ça en boîte ! », on nous le sert à toutes les sauces. Au menu ce soir avec Samsara : la beauté du monde, sauce curry. Est-ce que tu as autre chose à dire ou est-ce que tu comptes t’émouvoir jusqu’à plus soif ? Parce que là, avec tes images belles et dignes comme un catalogue d’obsèques, tu ne fais que t’égosiller comme un âne qui s’émeut de son sort sans capacité ni volonté véritable de s’émanciper. Ta liberté, c’est de t’émouvoir, et de t’indigner… Et après ? bah tu manges ton foin et t’avances. Tous les ânes sont contents : d’abord tu hennis, ensuite tu cavales. « Mais hé ! j’ai henni avant, hein ! J’avance moins con. »
Le monde est toujours beau dans sa laideur. Un lépreux qui se casse la gueule, c’est beau, parce que ça tombe en morceaux et ça fait de belles images au ralenti dans la poussière. Vois, regarde, émeus-toi, mais surtout, évite de comprendre. Regarde, émeus-toi, hennis, et accepte ton sort en chantant le sutra du démon. Parle à mes mains, demande à la poussière, parle à mon cul, ma tête est malade.


Avant le disque de Voyager, l’humanité avait envoyé une autre bouteille à la mer : la plaque de Pionneer. Et cette plaque présentait un homme et une femme étrangement statiques dans leur posture. On se disait : « Oh, mais l’homme a le bras levé, les extraterrestres ne vont-ils pas penser que tous les hommes ont la main ainsi levée ? ». Samsara fait la même erreur. Comme d’autres films de ce genre qui sont des best of, des cathédrales vides. L’instantané fige l’homme dans une posture qui préfigure déjà sa mort. La caméra glisse sur le monde, et le monde, lui, n’est déjà plus là. Ce sont les travellings de Nuit et Brouillard dans les camps : on ne filme de la Terre que ses fantômes, et il suffit presque d’en saisir un instantané pour lui donner le coup de grâce. Le « c’est dans la boîte » du chef op’ content de ce qu’il voit, c’est le même que celui du fossoyeur quand il nous dit son dernier adieu. Un cliché et tu meurs. Un clic et tu claques. Ces portraits d’hommes et de femmes sont des natures mortes d’hommes lobotomisés, des zoos d’images du monde où on laisse mourir nos beautés et nos laideurs en espérant les préserver telles quelles afin de pouvoir dire : « Voilà, c’est nous, sans fards ». Ou presque, hein, on n’oublie pas le curry.
On laisse la place aux apparences, au superflu, et on estropie le monde et les hommes de ses meilleurs atours : le langage, l’identité, l’histoire, l’intelligence… Tout cela est vaporisé par le 70 mm. Ces hommes robotomisés sont des zombis perdus à danser dans un nuage d’opium, et ceux qui les regardent sont condamnés à devoir y trouver une source de plaisir continu, infini, parce que capté dans la grosse boîte à images qu’est le cinéma. Écran large, écran total, y a plus rien qui rayonne.
Allez, arrête de tortiller du grêle, fume un joint, tu verras des éléphants roses et ça ira mieux.
Ah, la drogue, t’en prends une fois “pour voir”, en reprendre pour se perdre dans les excès folkloriques des contrées lointaines, c’est oser “le tapis”, faire face à la Mort et, en attendant qu’elle nous cueille, regarder défiler devant ses yeux toutes les beautés du monde… « Oh ! comme c’est beau… ! Ces images du monde ! »
Le petit chat est mort, mais je ne veux pas mourir. Assez d’images tendres qui tirent le catalogue des splendeurs du monde, si c’est pour me dire que tout cela sera bientôt crevé ou l’est peut-être déjà un peu. Parce qu’accepter sa mort prochaine quand elle est inéluctable, d’accord, mais ça devient obscène de vouloir montrer l’agonie en carte postale, comme s’il y avait de la beauté à voir disparaître le monde, à le voir tourner en rond, à le voir si absurde, ou beau, et de se dire : « Oh putain, tout cela est préservé parce qu’on a eu le temps de le mettre en boîte ! ». Les éléphants roses, ça ne vole pas dans le ciel, ça crève, ça agonise mais c’est encore là, et quitte à être convaincu de leur disparition, je préfère au moins en savoir plus sur eux, plutôt que me voir proposé des éléphants roses, ou blancs, traçant le ciel comme des comètes et faire un vœu pour sa sale pomme de merdeux ému.
Beauté de catalogue, encore et toujours. Constats sans issue. L’empaillage du monde sur papier glacé… Saloperie de cortège funèbre devant laquelle non seulement on reste impuissants, mais surtout, devant laquelle on doit encore et toujours s’émouvoir, comme forcés de se mouiller les yeux à la vue du Radeau de la Méduse. Posters, posters, posters-cravatte, et encore des posters. Ça s’encadre, ça donne l’illusion de préserver la nature des choses quand on ne fait que précipiter et accepter sa propre mort. Capturer le monde en 70 mm ne nous préserve pas de notre indifférence. Une fois mis en boîte, on l’ouvre, on renifle, on jouit, on pleure, ça disparaît, et on referme tout ça sagement avec la certitude d’avoir vécu quelque chose.
Rince-toi les yeux, et avec tes larmes, lave-t’en les mains.
Alors oui, en plus d’être vide et désincarné, le film, avec son air de pas y toucher, façon customize your own point, ou pose ton cerveau, ceci est une expérience sensassorielle, ça nous fait un chantage en trompe-l’œil. Parce que c’est beau merde, il faut que tu te laisses attendrir. Et pis c’est tout. Montrer cent fois la même chose, ce n’est plus dénoncer, ce n’est plus ouvrir des boîtes, c’est les multiplier industriellement pour les servir prêtes à la consommation. « Un documentaire ? Sur place ou à emporter ? ».
À partir d’un certain seuil, on ne montre plus sans écœurer, on ne dénonce plus, on ne défonce plus les boîtes ouvertes et on ne tire plus dans le poncif flamboyant façon puzzle. On fait, on propose, on expérimente, on ne se contente plus de montrer. On dé-montre. On adopte un discours. On baisse son froc. On ne se flatte plus sinon que de son opportunisme de pompes funèbres. On fusille le monde pour lui donner le coup de grâce.
Un hymne à l’ignorance.
Les images se succèdent sans qu’on ait la moindre idée de ce qu’on regarde. Tu trouves un trésor dans ton jardin, t’en profites pour toi seul, parce que c’est beau, ça brille, et putain merde, un trésor ! tu te fous de savoir ce qu’il y a derrière, les informations qu’il contient et qui ont plus de valeur que lui. On adopterait au moins l’angle du mystère, on simulerait un semblant d’unité à toute cette pièce multicolore, mais non, même pas, on s’en fout. C’est beau, c’est coupé à la serpe et c’est assez. La Mort en fait des confettis et danse le sirtaki ; et nous, on trouve ça joli. « Regarde et chante. » La mort aux dents, et le sourire aux lèvres.
Et celui qui voudrait dire non, qui chercherait un sens à tout ça, qui voudrait en savoir plus sur ce qui se cache derrière ces images, serait comme THX dans le film éponyme de Lucas. Un paria vomissant la drogue qu’on lui inocule et se tirant vite fait du monde sous cloche qu’on a concocté pour lui. L’absence de discours, le constat béat qui n’appelle plus de solution, qui se résigne à crever dans l’opium, en est en fait un, de discours. Le plus terrible : « Il t’est interdit de penser ; ne cesse jamais de t’émouvoir. » Jouis, jouis, toujours, vermine.
Opposer même la beauté du beau à la beauté du laid procède d’un autre triste constat : la mort de la raison.
Des images qui sont la contemplation d’un champ du cygne sans limite. Regarde-toi crever, Dieu. « Hé, tiens, tu ne voudrais pas partir sans la note, tout de même… Hé, voleur ! Au voleur ! »
Et puisque moi aussi, je chie mes commentaires dans une diarrhée contemplative pulvérisée à la serpe, j’en reviens à la musique. Elle peut, parfois, contribuer à la formation d’un discours, à le suggérer tout du moins. Pour cela, il faut user du contrepoint, des fondus de montagne, de divers procédés qui fassent sens, et proposer une unité d’ensemble à tout un fatras d’images sans rapport. Trop compliqué, ou inutile sans doute, quand le but est ailleurs. Décoratif. Le contrepoint ne viendra jamais, et la musique est au contraire une nouvelle injonction à se prosterner devant la beauté hiératique des images. Uniquement des images. Images sans paroles… Des petits riens de pète-culs qui brassent de l’air comme on agonise dans le désert, la langue sèche et pendante, à regarder un mirage comme une révélation tandis qu’on a le cul qui lâche ses derniers paravents et qu’entre deux ou trois spasmes funestes, les viscères rendent leur dernier souffle. Beau finale, je veux la même musique à mon enterrement. Le même gargouillis suppositoire. Aux regards vides et sinistres succèdent divers masques mortuaires, on s’invite aux funérailles du monde et on devrait trouver ça joli.
« Souris, le petit oiseau va sortir. Et tu vas crever, peeping Tom. »

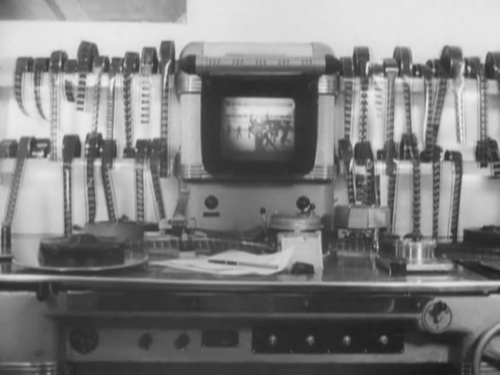
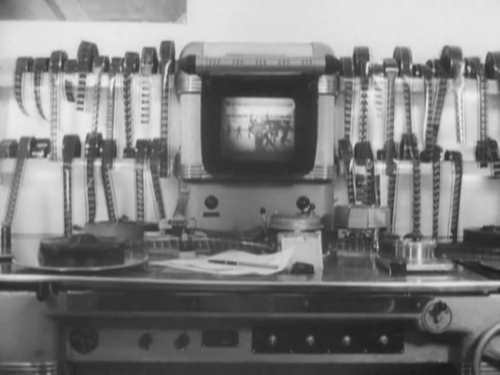

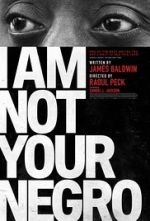 Année : 2016
Année : 2016


 Année : 2006
Année : 2006