C’est amusant de voir Christopher Nolan à la production, on sent parfaitement sa pâte dans ces opus franchisés DC Comics. L’absence totale d’humour, l’adoption systématique de la variante sombre de Batman, la musique laide d’Hans Zimmer, les dialogues insignifiants… Du Nolan tout crashé.
Dans le détail, le premier volet sur Superman peut encore tenir la route. L’acteur qui remplace Christopher Reeve est très limité : des muscles ridicules, mais il faut sans doute faire avec, c’est de circonstance, surtout une absence problématique de charisme et de charme. Le bonhomme fronce les sourcils vers le haut en permanence pour se donner un air à la fois gentil et concerné, mais il arrive juste à avoir l’air stupide. Si DC était cohérent, ils auraient centré leur personnage pour en faire un roc assez inexpressif, figé, sombre et sans la moindre douceur juvénile, or là on sent encore l’influence du premier film avec le charme doux de Reeve sans jamais lui arriver à la cheville. Un entre-deux pour le moins stérile.
L’influence de l’ancêtre cinématographique se retrouve également dans le choix du récit présenté : pourquoi nous resservir une nouvelle fois l’origine du personnage si c’était pour nous bâcler l’affaire à force de multiplier les bastons et les surenchères pyrotechniques ? Alors que le film de Richard Donner remplissait si bien cette mission ? Si on oublie ses origines, ça permet de se concentrer sur un Superman adulte et charismatique, déjà conscient de ses pouvoirs, avec une planète déjà à la page… Zorg peut alors venir se mêler à la fête. L’idée au début, d’ailleurs, de faire de Clark Kent un fugitif à la Wolfverine, c’est du grand n’importe quoi… Et je ne sais pas ce qu’il en est du Comic mais aussi peu crédible que cela puisse paraître, déflorer l’identité et la sexualité de Superman à travers Loïs Lane, ça me paraît une nouvelle fois pas franchement une grande idée (on les voit même baiser dans une baignoire dans le second volet, je sais pas, c’est un peu comme si Zorro sodomisait Bernardo derrière un buisson). Et puis, au bout de quelques minutes, Nolan oblige, on arrête de raconter une histoire, et ce n’est plus qu’une suite de séquences de baston à rallonge.
Tout cela empire dans le second volet. Le bal masqué attendu se mue vite en festival d’erreurs de casting. J’adore Ben Affleck, mais on se demande ce que Daredevil vient foutre dans l’affaire. Même s’il correspond assez bien à certaines variantes de Batman, le souci, c’est à la fois de le montrer saillir ses muscles en permanence (à l’image des acteurs de péplum des années 50-60, il est presque plus large que long) et de le diriger. Le monteur semble avoir peiné à trouver des plans de coupe de lui avec ses scènes avec Jeremy Irons (autre catastrophe de casting) où il ne soit pas ridicule. Et qu’est-ce que c’est que cette histoire de concurrence et de baston avec Superman ? Je n’ai absolument rien compris de pourquoi ils se crêpaient le chignon, encore moins pourquoi ils arrêtaient d’un coup (« ta mère s’appelle Martha ? ah bon ? OK, on arrête de se battre, copain », wtf). Lex Luthor uploadé dans une matrice Facebook, ça reste encore la pire idée qui soit. Djamel Debouze aurait tout aussi bien pu faire l’affaire à ce stade… Le scénario est incompréhensible. En revanche, on a le placement produit le plus classe de l’histoire : coucou, c’est moi, je m’appelle Wonder Woman et je suis aussi une marque DC Comics. Accessoirement cette Wonder Woman a été miss Israël et aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est la seule chose de réussi dans le film. Pas besoin de froncer les sourcils comme Superman pour avoir du charisme, pas besoin de soulever de la fonte comme Batman, non, assez convaincante. Dommage de ne pas avoir le produit Wonder Woman en stock, ça fait très envie pour le coup.


 Année : 2013-2016
Année : 2013-2016

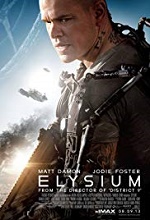






 Année : 2015
Année : 2015











