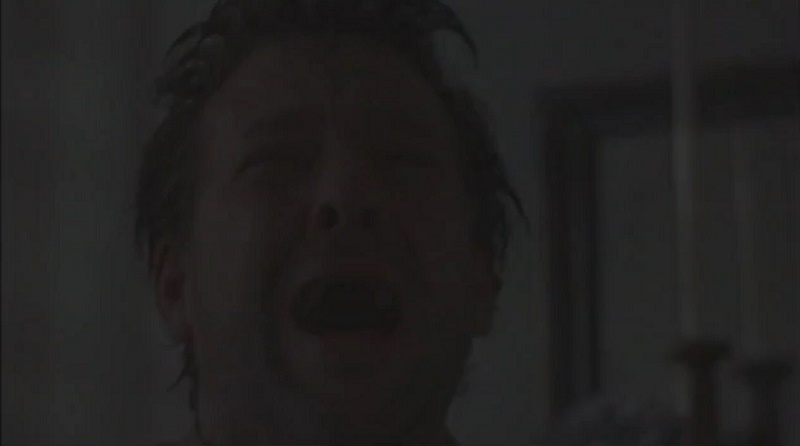Raté, mais plein d’enseignements à retenir.
Journal d’un cinéphile prépubère
La trame du film ne suit pas les méthodes conventionnelles et semble un peu se perdre en cours de route. On ne voit pas où tout cela nous mène. Certains spectateurs pensent qu’il y a plus de plaisir à suivre une histoire qui leur échappe totalement, où tout est imprévisible, mais je reste persuadé que c’est le contraire ; on ne prend jamais autant son pied que quand on revoit une histoire qu’on a oublié avoir déjà vue, et ce plaisir naît justement d’une familiarité qui nous échappe et nous procure une forme de confort salutaire.
C’est peut-être moi, mais le film semble souffrir d’un manque d’identification à l’égard du personnage principal. Comme si Rourke parlait une autre langue, qu’il appartenait à un autre monde. J’aime que mon chien, pour qui j’ai une grande sympathie, m’appelle au téléphone et me raconte sa journée ; je l’écoute parce que c’est mon chien et que j’ai de la sympathie pour lui. Avec Mickey Rourke, rien. Pas un appel, je reste insensible à ses préoccupations, sa quête, son histoire, ses démons.
Autre inconfort, la nature, ou le genre, du film. Qu’on ne connaîtra qu’à la fin. J’aime savoir ce qu’on me fait manger. Pains et viennoiseries possèdent les mêmes ingrédients, mais selon qu’on prépare l’un ou l’autre, les portions ne sont pas les mêmes. À la boulangerie, les étiquettes sont là pour nous aider ; dans un film, c’est le rôle de la narration. Concept flou, on doit pourtant la sentir : elle donne le ton et la direction du film. Or là, le message, l’enjeu, la direction ne sont pas clairs et donnent l’impression de s’improviser sous nos yeux profitant du moindre détail pour ouvrir de nouvelles possibilités narratives. Quand ça marche, on appelle ça des fausses pistes, quand ça ne marche pas, c’est des voies sans issue. Quand le spectateur se trouve face à un récit qui manque de cohérence, de but, qui obéit à des codes propres et improvisés, il peine à se trouver concerné par le sujet. Rien n’a été fait pour faciliter sa compréhension, c’est comme si on essayait au contraire de le noyer dans une gamme de détails, d’effets, d’ambiances, pour cacher les lacunes d’une histoire. Le jeu d’ellipses, devant servir à son imagination, si le lien, la passerelle, entre deux idées ou deux séquences est peu évident, à un moment, le fil de l’attention craque, et les ellipses qui suivent ne seront plus que des gouffres où le spectateur se perdra dans l’ennui. Tout est mesure, à-propos, bon goût, on peut donc imaginer que pour certains spectateurs ces effets ratés n’ont pas une si grande importance, mais c’était trop pour moi (ou pas assez). Le risque de certains récits opaques, ceux qui jouent cette fois sur le mystère, c’est de ne pas savoir en sortir soi-même. Une bonne dose de mystère interrogera le spectateur, et provoquera chez lui le plaisir de l’attente et de la simulation des possibles. C’est tout le dilemme du Petit Poucet qui doit à la fois semer ses cailloux régulièrement pour pouvoir retrouver son chemin et en garder suffisamment jusqu’à la fin. Mon fil d’Ariane à moi s’est complètement emmêlé dans une branche.
Peut-être n’ai-je pas été assez attentif au début du récit quand les éléments principaux doivent être mis en place, ou peut-être sont-ils mal présentés pour que le spectateur puisse avoir par la suite les clés pour trouver son chemin. C’est en ça que je dis qu’il n’y a pas de code. Le début d’une histoire doit posséder, presque toujours, une attaque, une catastrophe qui est une forme déjà de climax dont on ne verra que la fin ou une partie, et dont l’intensité doit marquer l’esprit du spectateur et lui dire clairement les enjeux à venir, quitte d’ailleurs à les changer en cours de route. Si les enjeux ne sont pas posés et qu’on décide de les découvrir au fur et à mesure, on se retrouve sans repères, lâchés dans un monde inconnu.
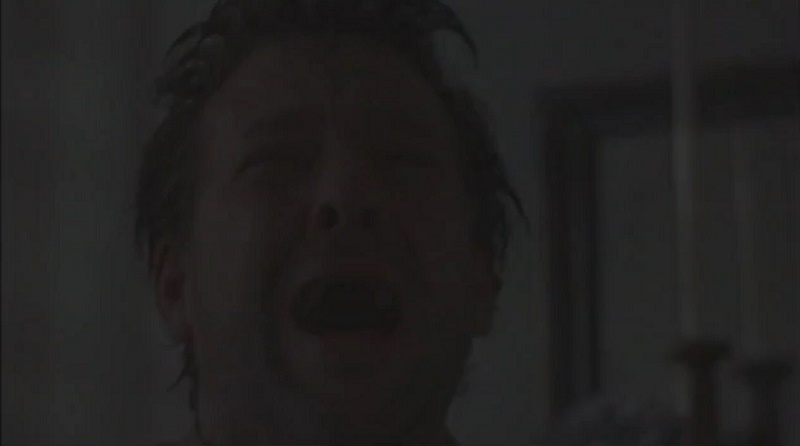
On commence donc par rechercher Johnny, mais cette quête perd très vite de son sens. Le récit (celui qui ne sait pas où il va) nous donne bien des indications, par flashs durant le film. Intéressant, sauf qu’on n’y voit que dalle. Des flashs, des flashs, d’accord, mais ils montrent quoi, ces flashs ? C’est comme nous mettre sous le nez l’odeur de la frangipane chaude à s’en badigeonner le visage, on cherche, on cherche, mais on ne trouve rien. Quand on est gourmand, c’est une déconvenue fatale. Il suffit d’une déception dans un film pour qu’on ne puisse plus être en mesure de rallumer la lumière en lui. La frangipane, il faut nous la faire bouffer au début, on en redemande, et la déception qu’on a alors quand on nous la refuse est tout autre : on sait qu’elle existe, ce n’est pas un mythe, nos papilles ont connu le bonheur infini du climax frangipanesque et sont prêtes à subir les pires souffrances pour retrouver ce bonheur. Cette attaque sert à bien imprégner nos mémoires et nos papilles. Le mystère vient souvent en arrière-goût, comme un prolongement pâteux et amer du plaisir immédiat, sucré ou salé, du premier contact. C’est bien pour ça que dans les films noirs, la femme fatale n’arrive jamais en début de cuisson. C’est toujours la cerise sur le gâteau, le pompon qu’on ne cessera alors de vouloir tripoter pour lui faire sortir les verres (brandy ou whisky) du nez.
La surprise finale tombe alors comme un soufflé. On fait « ah », on ajoute « voilà tout ? » s’il nous reste encore une goutte d’espoir dans le réservoir, et on retourne à d’autres occupations. La recette de fin pourrait renfermer le secret des pyramides de profiteroles que ce serait trop tard. La raison rétroactive, c’est souvent le premier argument avancé quand la sauce n’a pas pris. Non, non, la fin doit couler naturellement de la pièce montée, pas faire pschitt en inversant l’ordre des choses (et en particulier des attaques). Il n’y a qu’au cinéma où les histoires se terminent avec des bouchons de champagne qui sautent. Un bouchon, ça se dénoue tendrement, comme une évidence. Et le mystère persiste.


Angel Heart, Alan Parker (1987) | Carolco International N.V., Winkast Film Productions

 Année : 1986
Année : 1986
 Année : 1981
Année : 1981