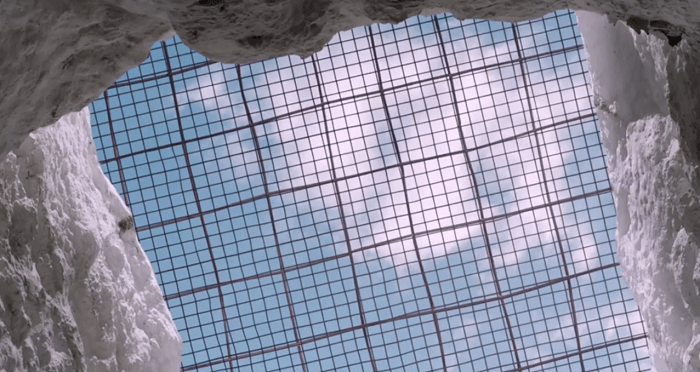Room
Année : 2015
Réalisation : Lenny Abrahamson
Avec : Brie Larson
Il y avait à peu près tout dans ce film pour me rebuter. Pourtant, si je sors du film satisfait, avec la conviction que malgré quelques défauts, c’est un bon film, c’est un peu parce que je lui reconnais l’incroyable exploit de ne pas me hérisser. La prouesse, c’est bien la somme de talent à déployer pour éviter le nombre faramineux de pièges qui se dressent devant vous quand vous décidez de vous attaquer à un tel sujet.
Reconnaissons pour commencer une première qualité de l’auteure du scénario (et du livre) : le fait de ne pas se concentrer uniquement sur la détention avec un récit concentré sur les diverses tentatives d’évasion. On échappe ainsi au thriller claustrophobe d’un goût douteux. Le récit décide ensuite de ne plus s’intéresser du tout aux poursuites ou aux recherches du ravisseur, et c’est encore à mon avis un excellent point. Le film se concentre alors sur la difficile reconstruction de la mère et de son fils, et ça, c’est plutôt un angle original parce que si le point de départ du film ressemble à certains faits divers glauques, au-delà très souvent de la sidération « biger than life » de voir que de telles situations peuvent exister, s’il y avait un sujet de film, il était bien de se concentrer sur l’après. Ce qui ne veut pas dire pour autant que cela en devienne moins casse-gueule. Dès qu’on touche aux faits divers, ou à ce qui en a l’apparence, à des événements à la fois aussi ancrés dans le réel mais difficiles à croire, la fiction n’est probablement pas le meilleur médium pour illustrer son horreur (disons que les faits divers ne sont jamais aussi bien placés — pour le public quel qu’il soit — sur la place publique, préservés des artifices vulgaires de la fiction dans les dernières pages qu’un journal quelconque). Jusque-là, bravo.

Ça se complique ensuite. Si on échappe au thriller séquestré dans une boîte à chaussure, on pourrait craindre d’un autre côté le drame calibré pour Sundance, avec ajout de poussière et de crasse sous les doigts désignés dans un lavabo d’effets spéciaux, avec les pires chemises à carreaux qui soit (neuves). C’est peut-être parce que le film est canadien qu’on échappe à ce nouvel écueil, mais force est de constater que malgré l’emploi de certains usages américains, on pourrait tout autant avoir affaire à un film européen (sorte de téléfilm Arte pour le sujet, mais qui pour sa maîtrise volerait à des hauteurs rarement atteintes par la petite chaîne franco-allemande). Ce n’est pas pour faire de l’antiaméricanisme primaire, mais plutôt parce que pour des raisons (esthétiques) qui me regardent, j’ai du mal à encaisser les films calibrés Sundance (ceux avec des stars dedans, qui ont accepté de baisser leurs tarifs, mais qui en plus de Sundance rêvent d’une petite nomination pour les Oscar). Il ne m’a pas échappé que l’actrice est une future vedette de chez Marvel, mais ne la connaissant pas, j’ai pu regarder sa performance sans souffrir d’un énorme hiatus plastique concernant sa présence dans un film crasseux où elle tire massivement la tronche.
La performance, c’est parfois important quand il apparaît dans la quasi-totalité des scènes, et forcément, dans ce type de films, c’est aussi un point potentiel sur lequel tout le film peut d’un coup faire fuir le public. Là encore, il faut le reconnaître, compte tenu du fait qu’on a affaire à un sujet des plus sensibles (casse-gueule), je trouve qu’elle s’en sort merveilleusement bien. Son jeu est contenu tout en restant expressif, et ça, ce n’est pas rien quand il aurait été si facile de se rouler par terre en pleurant ou, au contraire, de se dire qu’on aurait mieux fait de jouer tellement “contenue” qu’on exprimerait au final plus grand-chose. Chapeau donc. Parce que si certaines scènes sont compliquées à jouer par leurs excès intrinsèques, la difficulté est alors de trouver un juste milieu vers le “moins” qui fera qu’on parviendra à rester crédible. Je n’ai pas non plus vu d’effets trop tire-larmes ou d’appels trop évidents au pathos : même si on y a un peu recours, on échappe bien au pire.
On peut même dire la même chose au sujet du môme. Non seulement il est crédible, mais il arrive à ne pas trop taper sur le système comme c’est bien trop souvent le cas des acteurs en herbe si dévoués et “professionnels” au point de perdre toute spontanéité, fantaisie ou bêtise propres à leur âge. C’est d’ailleurs à travers lui que passe un des effets narratifs peut-être les plus lourds, “américains”, et forcément un peu inutiles, du film : on suit le film à travers le regard (en passant par la voix off) de son personnage. Le récit n’insiste pas trop sur le procédé, on échappe donc encore là au pire…
J’ai pu lire çà et là que le récit comptait trop d’incohérences. De mon côté, j’ai vite mis ces incohérences sur le compte du “naturalisme”. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le sujet se rapportait tellement à des faits divers connus que tout en échappant au rebutant « d’après une histoire vraie », on sait par expérience que dans la réalité, les gens ne réagissent pas forcément comme attendu, et que les détails les plus invraisemblables sont parfois les plus “réels” (combien de fois s’est-on entendu dire « ce serait dans un film on n’y croirait pas ? »). Alors, il ne faut pas multiplier les facilités ou les raccourcis (la mansuétude dont il m’arrive de faire part à l’égard de certains objets filmiques ayant ses propres limites), mais justement, je crois qu’on y échappe pas mal, et je pense même que certains détours ont réellement été choisis pour leur légère incohérence, et pour l’incrédulité qu’ils pouvaient susciter chez le public (vous êtes terriblement incrédule face à cet argument, n’est-ce pas ?). Un risque à prendre parfois : il faut alors faire appel à l’expérience et à la confiance du spectateur, à sa bienveillance aussi, afin d’éviter qu’il ne vous accorde plus aucun crédit face à de nouvelles incohérences qui seraient pour lui de trop (c’est un peu comme faire le pari de se foutre sous une guillotine et de faire confiance au public pour qu’il ne l’actionne pas…).
Écueil après écueil, c’est donc surprenant d’être passé à travers tout ça. Sans être brillant, le film me paraît maîtrisé, et je crois qu’on peut même dire qu’il arrive à changer en or ce qui se présentait à première vue comme du plomb.
Reste un dernier écueil. À quoi bon ? Et là, on retourne au piège du film écrit d’après un « fait divers ». Un fait divers vaut pour lui seul. On le raconte sur la longueur, et ça perd pas mal de son sens. Un fait divers qui s’étale sur la durée, c’est rare, et c’est presque toujours lié à une situation inchangée qui s’étale dans le temps. Faire le récit d’un événement assimilable à un fait divers et poursuivre sur autre chose, je ne peux m’empêcher de penser qu’il y a malgré tout là quelque chose de bancal ou d’injustifié (paradoxale, puisque c’est aussi un atout du film). Un peu comme il y a aucun intérêt à étaler une blague Carambar sur un film de deux heures. L’angle choisi qui est de se concentrer sur l’après est intéressant, assez bien exploité, mais si ce n’est ni divertissant, ni révélateur de ce que nous sommes, ni puissamment émouvant ou dépaysant, à quoi bon ? Certains y trouveraient en fait, je suppose, un certain attrait émotif, mais ma petite idée qu’ils se seraient en fait beaucoup plus portés par le sujet et que le reste aurait été le seul fruit de leur imagination (si dans la vraie vie, à l’écoute de tels événements, on est assez prompts à nous faire tout un film derrière les seuls faits entendus, on en est encore plus capables sur la longueur de tout un film). Parce que je n’ai justement pas l’impression que le film tombe dans les excès de pathos. Je le trouve même, sur la forme, assez froid et discret. Manque le génie, mais après tout, pour avoir échappé à une cascade de problèmes, il est peut-être là le génie. Et il faut sans doute s’en contenter.