On peut s’étonner de voir à quel point le film marche autant avec une direction d’acteurs aussi calamiteuse. Il y a des tonalités, ou dans certaines circonstances de jeu, il faut bien le reconnaître, qui dans le faux permettent d’apporter une distance avec les personnages et de ne pas alors être submergé par l’impression fausse, là, de réalité. La réalité est un mirage, une quête sans fin et probablement un peu vaine au cinéma, et c’est vrai qu’on peut tout autant arriver à donner du sens, et même des émotions, en représentant à l’écran des pantins. L’art de la représentation s’est toujours accommodé de masques, des symboles figuratifs, de représentations parfois très codées pour identifier des caractères, des personnages, sans jamais se soucier de reconstituer l’apparence de la réalité. C’est bien le cinéma qui a rendu nécessaire cette quête illusoire du “naturel”.
Or parfois, quand cette quête est laissée de côté, on en vient à se demander si ce qui semble s’imposer à chaque auteur et spectateur d’aujourd’hui est bien nécessaire. Parce que le sens de la fable, lui, passe toujours ; et l’artifice (le faux de l’acteur mal digéré) n’altère en rien la logique du récit.
C’est ce que Bresson avait bien théorisé, et c’est un peu ce que Rohmer faisait malgré lui en faisant appel à des acteurs pas forcément toujours médiocres mais mal dirigés et incapables (qui le serait ?) de prononcer “naturellement” des dialogues loin de l’être.
Pour ne pas avoir revu la Maman et la Putain, et Une sale histoire étant précisément un exercice de style sur la reproduction du faux calqué sur le vrai et donc la performance d’un acteur (et de son modèle), je pourrais difficilement me faire une idée précise de la “méthode” de direction qu’aurait pu utiliser Eustache dans ses (rares) films narratifs. J’ai toutefois comme l’idée que son attention était ailleurs. L’interprétation, le rendu ou la performance des acteurs, il ne s’en préoccupait pas et laissait un peu à la Rohmer les interprètes réciter des répliques dépouillées d’indications de contextualisation et de toute psychologie. D’où l’étrange impression parfois qu’en jouant mal ces acteurs deviennent des pantins. Alors, c’est sans doute moins systématique (car moins théorique) que chez Bresson (Ingrid Craven et Maurice Pialat tentent, assez bien, d’injecter du “naturel” dans leur jeu), mais on y retrouve sans doute malgré lui l’effet d’un Rohmer réussi. Et la clé ici, chez Rohmer comme chez Eustache, c’est l’ironie. Rohmer est chiant quand il se prend au sérieux, Eustache, c’est la même chose. On est bien sûr loin du Grand Blond avec une chaussure noire. L’astuce dans l’affaire, c’est d’avoir des répliques drôles (ou des situations, mais c’est plus rare) exprimées par des acteurs sans la moindre expression ou avec au contraire des expressions tellement fausses qu’on ne peut y croire. Et aussi étrange que cela puisse paraître, utiliser des pantins, jouer sur l’artifice, permet de se concentrer sur le sens. Aucune psychologie, ou sommaire, tout passe par les mots.

Mes petites amoureuses, Jean Eustache (1974) | Elite Films, Gala
Autre raison pour laquelle le style Eustache fait mouche, c’est son incroyable concision et son sens de l’ellipse. Avec de mauvais acteurs, des enfants a fortiori, les longs passages dialogués passent mal. Ça tombe bien, Eustache n’en utilise pratiquement pas (le garçon doit avoir une tirade que le cinéaste lui fait lire sur un panneau…). Eustache semble donner des indications scéniques, déterminer les places, les mouvements, et tout se fait dans une mécanique assez peu naturelle. Mais tout s’enchaîne parfaitement, non pas naturellement, mais logiquement, comme une structure, un événement qui se compose minutieusement. Ça pourrait paraître scolaire, sauf que ça fait mouche, parce que les répliques visent juste (tout en étant exprimées de manière fausse), elles sont drôles. Et Eustache n’en rajoute pas : il coupe après deux ou trois répliques, rarement plus. Il se fout ainsi de la continuité temporelle des séquences, et l’ellipse colle le tout assez bien, toujours pour aller droit à l’essentiel. C’est bien cette capacité de tailler dans le vif et de se débarrasser du “naturel”, qui fait toute la saveur, presque la fascination et la charme, de ce film. Ce sont comme des natures mortes qui s’affrontent, ou se séduisent plus précisément, dans le film.
Pour le reste, il s’agit sans doute de souvenirs personnels d’Eustache. Une telle audace aurait peut-être été impossible sans cela. Non pas qu’il aille trop loin dans ses séquences (le sujet traite de l’éveil sexuel d’un jeune adolescent) mais il arrive justement à suggérer beaucoup sans avoir à trop en dire ou montrer. Et c’est souvent cru ou naïf (ce qu’ajoute d’ailleurs le fait d’utiliser une narration en off du jeune garçon).
La tonalité aussi, en dehors de l’humour pince-sans-rire, fascine plutôt, parce qu’on y retrouve une forme d’insolence sourde, souterraine, qui jaillit parfois quand on ne l’attend pas. On sentirait presque poindre une envie de révolte à la Antoine Doinel ou la bêtise de Lacombe Lucien, mais tout reste le plus souvent retenu. Un peu parce que le jeu est très mécanique, mais aussi parce qu’Eustache laisse rarement l’intensité monter (vu qu’il coupe rapidement et use d’ellipses). Au lieu de voir ainsi une intensité monter dans un même mouvement, Eustache procède par flashs, photogramme par photogramme presque. C’est encore le meilleur moyen d’être concis et de faire confiance à l’imagination et la compréhension du spectateur, mais il s’interdit aussi l’expression de cette insolence qu’on ne fait qu’entrapercevoir. En suggérant ainsi l’insolence contenue, en ne la laissant jamais prendre son élan et s’exprimer pleinement, c’est comme si Eustache nous invitait à réagir à la place des personnages. Procédé éprouvé qui peut sembler paradoxal : pour gagner en identification (aux personnages, à la situation, au sujet), on use de distanciation. La mécanique d’Eustache (dans son jeu et son montage) permet mine de rien à ce qu’on nous intéresse à ses personnages. Certaines femmes qui veulent séduire ne procèdent pas autrement qui pour attirer les hommes se montrent distantes… Ce n’est pas l’histoire qui vient vers le spectateur, c’est lui qui vient à elle. Tout un équilibre à trouver : être trop envahissant, c’est donner au spectateur l’impression qu’on l’agresse et lui force la main (et on le perd) ; être trop distant, sans avoir par ailleurs de quoi animer son intérêt, c’est presque le risque de le perdre pour de bon… L’art, c’est aussi (et surtout) séduire. Et Eustache, peut-être malgré lui, avait cela en lui. Il y a certains mystères, certaines alchimies qui échappent parfois aux auteurs qui les composent. C’est le cas de ces petites amoureuses.


















 Année : 1917
Année : 1917
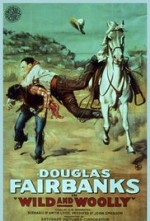





















 Année : 1937
Année : 1937
