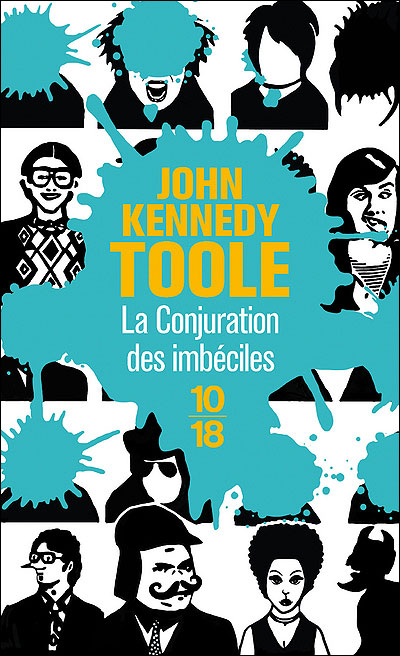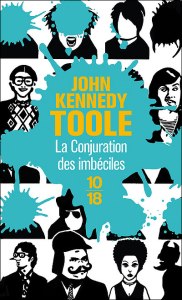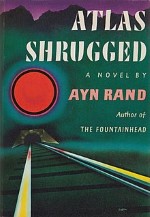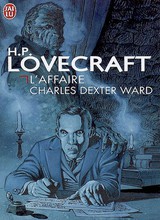Commentaires croisés
Les événements actuels aux États-Unis (tentative d’assassinat et réélection de Trump) m’ont incité à lire le roman et à revoir le film. J’avais écrit une vieille critique (presque vingt ans) que je n’ose relire, et je me suis essayé très brièvement (ça m’arrive) à la comparaison entre quelques éléments séparant et réunissant Stillson et Trump ici.
Mais cette lecture a surtout été l’occasion de repérer la manière dont l’adaptation avait été remarquablement faite. King a une écriture très visuelle et la structure de ses récits pourrait ressembler à du cinéma. Il serait donc tentant de coller parfaitement à la trame de son histoire, sauf que tout en empruntant pas mal des caractéristiques du cinéma (le montage alterné notamment), l’écriture de King adopte par ailleurs un certain nombre de procédés ou d’approches impossibles à réaliser au cinéma.
Il y a 28 chapitres dans le roman, et à peu de choses près, c’est le nombre de séquences dans un film. Le problème, c’est qu’à l’intérieur de ces chapitres, King y inscrit souvent différentes « séquences » supplémentaires, ce qui reviendrait à faire quelque chose qui ressemblerait à des montages-séquences. Impossible, à moins de se prendre pour Coppola, de s’en tenir à la structure du romancier. Malgré les apparences, aucun scénariste n’aurait pu faire l’économie de pas mal de coupes.
Plus intéressant encore : la manière dont Boam concentre le temps du récit autour de quelques mois si l’on met le prologue à part : cinq ans avant le temps du récit, puis l’histoire semble cantonnée aux saisons froides de la région. C’est peu ou prou un temps très cinématographique. En effet, la durée des événements diégétiques excède rarement quelques mois.
Si à l’époque du cinéma muet, de nombreux mélodrames jouaient sur les possibilités du cinéma de passer d’une époque à une autre, tout le monde s’est peu à peu rendu compte que cette possibilité se heurtait à un problème : changer d’époque implique de modifier l’apparence des personnages, et par conséquent les vieillir. Et c’est rarement crédible.
L’astuce dans le film est capillaire, uniquement capillaire. Les autres personnages n’ont pas à être vieillis parce qu’on ne le voit pas dans l’introduction.
Celle-ci est par ailleurs profondément remaniée : King se perd dans une interminable séquence de jeu de hasard et insiste sur les relations entre les deux amoureux, le tout en mêlant aux passages dédiés à Johnny d’autres concernant deux criminels de l’histoire.
Boam ne se complique pas la tâche : une intro, ça sert à introduire. En cinq minutes, c’est plié.
Astuce amusante, Boam élimine tout le début racontant l’accident de hockey de Johnny pour le réintroduire plus tard, mais cette fois pour l’appliquer au personnage dont le médium est le précepteur : on passe du football et à l’adolescence au hockey et à l’enfance. Boam peut supprimer ainsi toute la partie devenue inutile sur l’épisode de l’incendie.
En condensant l’action sur quelques mois, cela permet également de le faire sur l’élection de Stillson, alors que dans le roman, Johnny suit d’abord l’ascension de Carter et celle du psychopathe se fait plus lente.
Inutile de multiplier les événements précédant la rencontre avec le futur autocrate, et dans le film, l’accent est surtout mis sur l’enquête du tueur en série menant à l’implication d’un des flics de la ville. Toutes ces péripéties dans le roman ont une épaisseur relativement identique. Dans le film, cela vient crescendo et des liens logiques apparaissent : si Johnny accepte la proposition de devenir précepteur (ce qui lui permettra de rencontrer une première fois Stillson), c’est parce qu’il doit faire face à différents événements trop pesants pour lui : la mort de sa mère, la brève relation avec Sarah qui signifie aussi la fin de leur relation, la presse et les fans qui s’intéressent bien trop à lui depuis qu’il a aidé à résoudre les crimes mystérieux dans la région.
Dans le roman, Johnny part vivre des mois, voire des années, à l’ouest du pays où il se fait oublier (évidemment, dans un film, changer ainsi de région, d’univers est quasiment impossible, l’unité visuelle, donc géographique, est trop importante pour la cohérence du film). Ce retrait volontaire (qui se manifeste surtout par une fine ellipse : il ne se passe probablement que quelques jours entre la première rencontre avec l’enfant et la leçon qu’il reçoit chez Johnny dans sa nouvelle maison) et le recours à un enfant plutôt qu’à un adolescent permet de prendre une légère respiration avant de venir à l’événement majeur qui conclura le film (et l’on sait combien King a des difficultés souvent à livrer une fin à ses histoires).
Il n’y a pas que des avantages à se restreindre à de telles coupes : ainsi, les raisons du titre disparaissent dans le film alors qu’elles sont évoquées à la fin du roman. Les migraines qui préfigurent l’état de santé de Johnny et sa tumeur existent dans le film, mais on les attribue à l’accident. L’accident initial (l’harmatia en quelque sorte) transféré ainsi de l’enfance de Johnny à son élève qu’il sauvera de cette fin tragique n’a donc plus de raison d’être si tout l’aspect lié à la tumeur disparaît : Boam s’est passé de ce qui était explicatif dans le roman de King. Aucune raison véritable à justifier médicalement les visions de Johnny, encore moins à précipiter son meurtre en se sachant condamné.
Le film s’achèvera d’ailleurs sur la séquence de l’assassinat raté. King, de son côté, surfe ensuite sur l’émotion et sur l’explication en imaginant des lettres écrites par Johnny. Un tel épilogue se rencontre parfois au cinéma, mais on sent dans le scénario de Boam une volonté d’aller droit au but et de proposer un récit droit, froid, presque clinique, voire scolaire, mais terriblement efficace. Une fois Johnny assuré qu’il avait modifié le futur, il n’y avait aucune raison de s’attarder si autre chose que les larmes de Sarah (que Boam a très judicieusement impliqué dans la campagne de Stillson). Comme pour Shining on dira, Stephen King, c’est encore les autres qui en « parlent » le mieux. L’auteur peut critiquer les adaptations tant qu’il veut, il doit probablement une large partie de son succès à ces adaptations plus réussies que l’original.
Dans ce qu’on peut lire de la biographie du scénariste sur Wikipédia, on comprend que Cronenberg a soumis à Boam une série d’indications qui se sont révélées judicieuses pour gagner encore en simplicité. L’ironie, c’est que dans beaucoup des succès des adaptations des histoires de King au cinéma dans les années 80, la sophistication y est prohibée. Pourtant, les romans n’en sont pas totalement dénués. Elles gagnent ainsi à l’écran un côté conte pour enfants qui aura probablement participé en retour un peu plus au succès du romancier du Maine…
Dead Zone, David Cronenberg (1983) | Dino De Laurentiis Company, Lorimar Film Entertainment
Sur La Saveur des goûts amers :
— TOP FILMS —
Stephen King et la prédiction de l’ascension de Trump dans Dead Zone
Ancienne critique du film (journal d’un cinéphile prépubère, 1996)