Masculinistes et féministes dans nos sociétés d’aujourd’hui ne sont parfois plus que d’affreux sexistes versant sur les représentants du sexe opposé leur petite haine xénophobe (au sens travesti), qui ne voient les maux dont ils souffrent, ou les luttes (légitimes ou non) qu’ils veulent mener, qu’à travers le prisme du genre. On prend un parti, et on ne s’en départ plus. D’un côté comme de l’autre, il faut assumer sa connerie, son idéologie, jusqu’au bout. Du militantisme au fanatisme, il n’y a qu’un pill. Ou un isme. C’est ce que j’exprimais déjà dans mon billet sur les totems de l’idéologie (plutôt axé sur le terrorisme toutefois, mais qui vaut pour toutes les formes de petites haines qu’on légitime à travers un discours victimisant — que ce discours soit légitime ou non, qu’il soit efficace ou non, c’est une autre histoire). Voir donc un film réalisé par une femme se présentant comme féministe sur les groupes activistes masculinistes ne pouvait alors que m’intéresser. Encore plus quand on sait que le film a eu les plus grandes peines du monde dans certaines villes à sortir car jugé antiféministe (la censure autorisée des bienveillants tâcherons du politiquement correct). Il est toujours bon de s’informer des bêtises du monde qui nous entoure et de l’ironie de certains comportements d’individus censés être (ou se présentant comme) libéraux quand ils ne le sont en fait d’abord que pour eux-mêmes, et surtout pas pour d’autres qu’ils se chargeront de désigner.
Attention, une femme au volant.
Le ton du film commence pourtant mal, on n’a pas vraiment affaire à un documentaire, mais à un exercice étrange qui relève plus du journal ou de l’enquête tout terrain à la Michael Moore. Le problème de ce genre de films présentés un peu à tort comme des documentaires, et qui fait principalement leur faiblesse, c’est l’utilisation assumée et revendiquée de la subjectivité. L’exercice de l’objectivité est bien sûr difficile à tenir mais c’est une question de direction, de choix, de volonté. On ne sera jamais, à travers un documentaire ou non, objectif, mais c’est la volonté affichée de l’être qui est respectable, et qui… fait illusion. Je ne vois pas meilleure approche pour informer. En optant délibérément pour la subjectivité, l’auteure du documentaire, Cassie Jaye, se met elle-même dans une situation délicate puisqu’elle questionne en temps réel ses propres convictions, et se met en scène en train de se laisser convaincre par des arguments tout aussi biaisés que ceux l’ayant fait adhérer auparavant à ce qu’elle croyait être du féminisme (le féminisme bon ton, celui des petites filles, le même qui les poussent à se faire un piercing sur le nombril à 15 ans comme signe d’émancipation face à l’intolérable carcan familial, pardon, patriarcal). Ce qui me chagrine le plus souvent dans cette approche personnelle, c’est qu’on traite d’un problème général à travers le prisme de l’émotion et de l’expérience personnelle. Et ce n’est pas que cette approche soit moins légitime au cinéma (mes billets sont tout aussi, voire plus, personnels et n’ont aucune prétention à viser l’objectivité), c’est qu’elle me prive peut-être un peu de l’intérêt que j’aurais pu avoir à profiter d’un film traitant d’un même sujet mais abordé dans une optique plus objective… Plus qu’avec aucun autre film de fiction, le documentaire peut être ainsi une source de frustration pour celui qui le regarde car il ne verra jamais au fond le film qu’il aurait voulu qu’on lui montre…
L’émotion est donc au cœur du film, et le discours de ces hommes faisant part de leur souffrance touche la cinéaste, et à force de s’en trouver affectée, commence à remettre en question ses certitudes et à adhérer à une vision du monde qu’elle croit guidée par de gentils idéaux (les mêmes peut-être qui l’avaient poussée à adhérer au féminisme). Une idéologie (une religion, un dogme, un dieu, un totem) en remplace une autre. L’homme (ou la femme) n’est jamais aussi bien dressé que quand il se met à genoux devant un totem. Cassie Jaye ne comprend pas les processus biaisés qui l’ont conduit jusque-là dans une idée qu’elle se faisait du monde et qui la mène une nouvelle fois à penser différemment mais en fonction toujours des mêmes travers. Elle pense être guidée par les idées, la raison, quand elle ne l’est que par l’émotion et les mirages de la sophistique fumeuse qui entoure toutes ces idéologies (on retrouve les mêmes processus de pensée dans la partisânerie que dans n’importe quel fanatisme).
Je doute donc de la démarche, mais ça tombe bien puisqu’à mon doute répond celui de la cinéaste (on est loin de Michael Moore, et ce n’est pas si mal). Peut-être finalement, me dis-je, qu’il y a un intérêt à voir le film qui m’est présenté, et que j’aurais mieux fait de cesser de me plaindre de ne pas voir celui que j’aurais voulu voir. Chacun tâtonne, un pas dans un sens, un pas dans l’autre, bientôt je danserais avec Cassie Jaye.
C’est moi qui conduis. Attention aux pieds.

La cinéaste, sans doute par un souci d’équité ou de semblant d’objectivité, décide de confronter l’avis des masculinistes à certaines autorités féministes. Et avant que leurs propos (ou leur attitude) finissent par les décrédibiliser tout à fait (la palme à la directrice du magazine Mrs., Katherine Spillar, qui se montrera au fil des interventions toujours plus intolérante et stupide, en particulier dans sa manière… misandre, d’évoquer la conception d’un enfant comme s’il était en fait question d’une maladie inoculée par les hommes aux femmes…), l’une d’elles (c’est un homme) dit justement à propos des masculinistes : « Grandissez un peu, on ne peut pas confondre la souffrance avec l’oppression ». Sauf qu’on aurait envie de lui dire que cette sage affirmation vaudrait tout aussi bien pour des femmes occidentales du XXIᵉ siècle.
C’est sans doute ce que se dit à ce moment l’une d’elles, celle qui précisément réalise le film.
Mais soit, peut-on imaginer, sans aller jusqu’à parler d’oppression, qu’il puisse être utile, significatif, d’évoquer des réalités statistiques pour concevoir un peu mieux le monde dans lequel nous vivons, et par là donc prendre conscience de certains travers de nos sociétés, établir des constats pour le bien-être de tous, autrement dit ici, peut-on faire état de certaines souffrances et supposées inégalités sans se faire traiter de tous les noms ? La question serait de savoir aussi si ç’a un sens de parler de « réalités statistiques ». Et là encore, ce qui vaudrait pour les hommes (ou leurs revendications), pourquoi devrait-on a priori l’accepter quand il est question des droits et des revendications des femmes ? Hein, a priori ? (C’est un outil très répandu pour faire état de certaines inégalités en défaveur des femmes.) Reste que certains constats sociologiques (au-delà donc d’une certaine réalité difficile à concevoir quand on cherche à s’émanciper des biais propres aux statistiques), sans avoir à préjuger de qui, des hommes ou des femmes, auraient tout intérêt, et légitimité, à être évoqués. Les féministes parleraient alors (on m’excusera pour le procès d’intention) d’indécence à parler de certaines statistiques (« profitable » à la souffrance des hommes, ou révélant des inégalités supposées en défaveur des hommes — j’insiste encore une fois sur le caractère supposé de ces inégalités parce qu’elles s’appuient sur des statistiques) quand d’autres en défaveur de femmes illustrent d’un bien plus grand déséquilibre (ce qui serait tout à fait acceptable si le discours féminisant ne venait noircir le tableau plus que nécessaire en évoquant l’oppression issue d’une « société patriarcale », s’écartant alors du seul constat à propos d’un sujet précis pour le généraliser à une idéologie plus globale, et ainsi dresser les femmes contre cette oppression supposée que les hommes exerceraient sur leurs victimes — sophisme à l’insu de leur plein gré ou manœuvre malhonnête, peu importe).
Parlons des suicides par exemple. Les hommes seraient beaucoup plus touchés que les femmes. Victimisation, masculinisme ? Peut-être. Mais est-ce que le constat une fois établi (et si on met de côté, toujours, les biais statistiques qui ont pu mener à un tel résultat) peut permettre, au-delà de toute considération sexiste et idéologique…, non pas précisément à réduire un déséquilibre entre hommes et femmes (l’erreur ici serait de penser qu’il y a une discrimination) mais à identifier des troubles, des comportements propres à certaines populations (il se trouve ici qu’il est question des hommes) afin de commencer à régler un problème sans considérations liées au sexe (j’insiste, l’idée ne serait pas de créer un équilibre des suicides entre hommes et femmes, mais simplement de comprendre qu’il y a une prévalence des hommes au suicide). Dans la même idée, je suppose (désolé de ne pas vérifier) que les femmes sont plus touchées, cette fois, par les tentatives de suicide : moins radicales, elles sont aussi l’expression d’un trouble qu’il faut traiter, et savoir quel type de population est plus susceptible d’être touché, ça participe à comprendre les processus psychologiques et sociologiques qui les provoquent… Et je reviens sur la question des biais statistiques : la seule chose à comprendre, c’est qu’elles ne peuvent et ne doivent pas être utilisées comme une arme pour s’opposer à l’autre sexe. Ce qui vaut pour les mouvements masculinistes vaut pour les mouvements féministes occidentaux du XXIᵉ siècle. Parce que s’il y a un intérêt statistique à connaître le taux de représentation des femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises ou dans les parlements, ça trace un constat qui ne peut être inclus dans une démarche idéologique. Un constat aide à régler un problème précis, si c’est pour venir alimenter une idéologie, et en particulier la théorie farfelue du patriarcat, non. Il y a ceux qui veulent régler les problèmes, éviter soigneusement le piège des stéréotypes, et il y a les écervelés et les cons qui prennent des moulins pour des géants ou qui veulent renverser les souverains de leur trône pour s’y mettre à la place (comprendre : renverser une oppression — parfois fantasmée — par une autre, qui deviendra, elle, bien réelle si ces fanatiques gagnaient leurs révolutions en carton).
Petit interlude explicatif et positionniste entre deux tunnels fibreux. S’il fallait faire dans l’aveu d’appartenance à une idéologie, je confesserais bien une petite attirance (mais j’essaie de ne pas trop m’y soumettre sachant, moi, à quel point il est dangereux de se laisser guider par les idées plus qu’en devenir soi-même le maître, na !) pour l’égalitarisme (l’italique le rend encore plus sexy). Bien sûr, ç’a moins de couilles que de se prétendre féministe, c’est moins victimisant qu’être masculiniste ; mais voilà, je dois l’avouer, s’il y a de l’oppression, dans un côté ou d’un autre… il faut que cela cesse ! s’il y a des discriminations, quelles qu’en soient les causes ou les victimes, il faut que cela cesse ! s’il y a des préjugés, en tout genre, il faut que cela cesse !… C’est ma grande faiblesse, je l’avoue. Petit, déjà, je m’en voulais que ma main droite prenne le pas sur la gauche, et depuis lors je m’applique à jamais la négliger en me faisant plus ou moins ambidextre. C’est un combat de tous les jours, l’égalité (ou comme l’objectivité qui me manque dans ce commentaire) est un vœu pieux. C’est l’intention qui compte comme disait l’autre.
Pour en revenir au film, s’il y avait une punchline (un piège rhétorique, ou une manœuvre de la sophistique qu’elle soit induite par la main gauche ou par la droite) qu’il faudrait retenir, énoncée dans le film par son auteur Warren Farrell, c’est la suivante : « Si la femme est vue comme un objet sexuel, l’homme est vu lui comme un objet à succès ». À méditer. (Une affirmation suivie d’une autre tout aussi mignonne, avec tout ce que peut avoir un aphorisme de ronflant : « Les femmes ne peuvent pas entendre ce que les hommes ne disent pas. » Ce qui est passionnant dans les aphorismes, c’est qu’ils ont toujours raison ; ils sont implacables. Malheureusement tout cela sera suivi d’une autre affirmation ébouriffée d’une tout autre manière, et revenant sur nos inévitables biais statistiques, à savoir que 93 % des personnes décédées sur leur lieu de travail sont des hommes. D’accord, bon, au-delà du fait qu’on croit voir des résultats dignes des meilleures publications de l’université de Sherbrooke pour mesurer les bienfaits du café sur l’obésité, on met surtout en exergue l’argument féministe, là, renvoyant à l’image de la femme qui ne se tue pas au travail et pour cause puisqu’elle reste à la maison. L’art d’interpréter les statistiques jusqu’à l’absurde.)

Au moins, il faut l’avouer, contrairement à ce qui a été dit par les tenants du pseudo-féminisme, ces fanatiques sexistes de l’intolérance pour tous sauf pour eux, on pourrait difficilement malgré tout voir ce film (à travers son auteure) comme de la propagande masculiniste, voire antiféministe. L’égalité pour tous ; la bêtise est plutôt bien partagée entre les groupes (malgré une subjectivité assumée de l’auteure un peu terrorisante pour qui rêverait d’une approche plus froide, il faut reconnaître aussi que cette approche lui permet, à travers ses doutes parfaitement mis en scène, d’exprimer quelques réflexions bien senties). Hommes et femmes en prennent donc chacun pour leur grade : les hommes (masculinistes, mais les hommes féministes présentés font tout autant peine à voir) avec leurs sophismes ou leur délire de persécution (léger toutefois), les femmes (pseudo-féministes, activistes à la con, sexistes, féministes avariées en lutte contre une société qui n’existe plus depuis cinquante ans — ah, c’était mieux avant, quand se révolter avait un sens, quand tout était à gagner… alors que les femmes aujourd’hui, pour exprimer leur inclination à la révolte, sont réduites à des hashtags sur le manspreading entre un tweet sur le meilleur rouge à lèvres et un autre sur son assiette instragramée et délicieusement estampillée végane dans le dernier restaurant à la mode) avec leurs injures et leurs ad hominem incessants (on en voudrait presque toutefois à l’auteure, cette fois, de n’avoir interviewé que des pseudo-féministes, quand d’autres probablement plus mesurées, plus honnêtes ou simplement moins débiles, auraient probablement porté un regard plus éclairant à la fois sur les différentes formes de féminisme, mais aussi bien sûr sur la perception de ce féminisme moderne face aux revendications souvent incomprises des masculinistes). Aucun débat possible, donc (sauf peut-être dans la tête de l’auteure du documentaire, et c’est peut-être malgré tout, ce qui est le plus intéressant à suivre, le plus… émouvant, à force de suspecter chez elle, ou à voir prendre forme à travers ses petites vidéos personnelles, un peu moins de certitudes), parce que tous (et toutes) sont des cons, et/ou intolérants à l’intolérance de l’autre. Aucune mesure possible (la mesure, je le rappelle, c’est ce qui aide à l’égalitarisme, mais je dis juste ça comme ça), et la seule volonté de critiquer l’autre ou de l’humilier. Qu’est-ce que disait Yoda déjà (mais c’était il y a bien longtemps) ? La haine engendre la haine… Voilà.
Là, en revanche, où je m’inscris totalement dans la démarche de certains de ces gourous du masculinisme, c’est quand ils font à leur tour la chasse aux faux-semblants, aux idées reçues, aux manipulations, propagées par le discours pseudo-féministe, notamment quand une partie du discours actuel de ces féministes est axée sur l’illusion d’une société du patriarcat, suggérant par là qu’il y aurait comme une ligue des hommes pour oppresser les femmes, ou que les hommes se serreraient les couilles pour se garder le gros du morceau du pouvoir pour ne pas en laisser aux femmes… On est (dans cette critique d’un certain féminisme rétrograde) dans une optique de lutte contre les préjugés et biais cognitifs des plus communs qu’on retrouve à travers différents groupes sectaires ou conspirationnistes (encore une fois les idéologies procèdent de la même façon que les sectes ou les religions, à savoir que c’est l’idée qui nous forme plus que c’est nous qui formons l’idée). Ce serait plus efficace si cette manière de casser le totem, et les sophismes du discours sexiste d’en face, ne servait pas à en construire un autre cela dit (à croire qu’on n’écoute que ceux qui dressent des totems), et cela, justement parce que le film est trop subjectif, on ne le voit pas assez. Si la question de la supposée oppression tient debout et discrédite presque à elle seule le discours du féminisme radical actuel, les exemples statistiques biaisés jusqu’à la moelle foutent en l’air tout un discours qui aurait pu être mieux entendu. Les statistiques, on peut leur faire dire n’importe quoi ; et cela vaut à la fois pour les tenants du masculinisme comme pour ceux du féminisme.
Égalitarisme ! Roulons au centre ! Protégeons-nous des extrēmes en foutant des macrons partout !
(Heu, non, t’as pas du tipex ?)
L’un des discours les plus intéressants du film est à mettre au crédit de certaines femmes d’un groupe de défense des droits des hommes. L’une d’elles questionne le féminisme comme chacun devrait être capable d’interroger sa propre propension à s’identifier, à se définir, à réfléchir en fonction d’une idéologie plutôt qu’à travers sa propre petite cervelle ; et elle évoque ainsi ces femmes qui se définissent souvent sans y avoir réfléchi comme féministes, en parlant de confort. Le confort de celui, ou celle, qui remâche un discours structuré et approuvé par d’autres. Elle évoque ainsi une histoire au Nigeria qui avait fait le tour des médias dans laquelle les sociétés occidentales s’étaient émues du sort de centaines de jeunes filles kidnappées par des djihadistes. Avec raison, elle précisait que si ces femmes avaient été enlevées, c’était certes parce qu’elles étaient des femmes, mais ce qu’on oubliait de dire (ou de penser), c’est que si elles avaient été des hommes, elles auraient été tuées comme les autres. (C’est un moindre mâle.) Il faut faire un effort d’intelligence pour ne pas tomber dans le piège de certains biais cognitifs dont nous sommes tous victimes, parfois pour se refuser aussi à juger d’une situation en fonction de l’avantage qu’on pourrait y trouver (il y a une forme de complaisance à participer à des mouvements de revendication pour lesquels notre participation est gratuite et sans risque, et grâce auxquelles, même, on peut y gagner la bienveillance et le support des autres). En revanche, là où cette même personne tombe dans la facilité ou les préjugés, c’est quand elle affirme que les terroristes savaient que s’en prendre à des femmes leur donnerait de l’attention, qu’ils étaient parfaitement conscients de ce qu’ils faisaient parce que c’était bien ça, l’attention, qu’ils recherchaient. Et oui…, l’intelligence, c’est une lutte permanente contre la facilité. Jacques Brel disait que tout le monde était intelligent, et que l’intelligence n’était que l’effort que chacun faisait pour être un peu moins con. Il y a de ça dans les postures pseudo-féministes de certaines personnes (hommes, femmes, et ça vaut autant pour les féministes que pour les masculinistes une fois qu’ils tombent dans le piège du confort de la pensée, du ralliement à une idéologie ou à ce qu’ils pensent être une « cause »). Parce qu’il est certes confortable, voire gratifiant, pour une personne de se définir en fonction d’une idéologie en vogue et pour laquelle elle ne court aucun risque. C’est cool, c’est la norme de se définir aujourd’hui comme féministe (alors que…, mettons…, il sera plus compliqué pour une femme de se définir comme entrepreneur, d’affirmer des ambitions politiques ; c’est bien de s’en plaindre, mais pourquoi ne pas faire en sorte que cela devienne plus cool ?). Intégrer un mouvement de pensée qui vous donne à la fois l’image d’une personne responsable civiquement, active voire revendicatrice de certains droits fondamentaux, prétendre alors aller à l’encontre du pouvoir établi (d’où la nécessité par ce biais de se voir lutter contre un oppresseur désigné, quitte à l’inventer, et ce sera ici la « société patriarcale ») quand en fait, c’est tout le contraire. Car si dans les sociétés occidentales certains droits peuvent être encore à gagner pour les femmes, si surtout dans l’usage de nos sociétés beaucoup d’inégalités, de discriminations ou de préjugés (dont les « femmes » sont parfois à la fois victimes et responsables) ont encore cours, participer à une idéologie féministe aujourd’hui, c’est se fondre dans le moule de la facilité et de la pensée prémâchée par d’autres. Il est de bon ton, pour être dans son époque, de se revendiquer, qu’on soit un homme ou une femme, féministe, parce que c’est suivre le vent, et c’est s’interdire comme le disait Brel tout effort d’intelligence. On est sûr d’avoir le beau rôle comme on pouvait être sûr de l’avoir en étant révolutionnaire en 1795, bonapartiste en 1800 et napoléonien en 1805. Certaines personnes se placent toujours dans le sens du vent pour avancer plus vite et pour s’interdire d’avoir à penser, surtout, devoir assumer des convictions portées par leur seul jugement, parce que cela peut se révéler dangereux et inconfortable. Il y avait un inconfort certain pour des individus dans les années 60 à se revendiquer féministes. Et parce que la société avait changé, le féminisme à cette époque a aidé à forger notre présent. Reste que certaines personnes ne comprennent pas comment les droits se gagnent ou comment on pointe du doigt les inégalités, et tombent dans le piège du systématisme et de l’idéologie. Par confort, ces personnes agissent contre les causes qu’elles prétendent défendre, principalement en cherchant à combattre des moulins qui n’existent pas, en s’inventant une société du patriarcat dont elles seraient les victimes, au lieu simplement de lutter contre les inégalités quelles qu’elles soient, les discriminations ou les préjugés. La loi et l’usage. Le pouvoir du législateur et celui de la société. La société a parfois de l’avance, et elles poussent les lois à se faire ; d’autres fois, c’est le contraire, les lois sont là, mais ce sont les consciences qui tardent à se faire, ou à évoluer, et alors, les luttes d’autrefois se répandent comme un écho rassurant dans une prison qu’on est le seul à se bâtir, face à un oppresseur qu’on est le seul à voir.
On peut éprouver parfois dans le film, à l’évocation de certains discours masculinistes, un certain malaise quand ils demandent de la compassion face à leur souffrance. Certes, personne n’a le monopole de la souffrance, et certaines de leurs revendications sont légitimes ; mais comme dans toute idéologie, ce qui lorgne très volontiers vers la bêtise, c’est quand ils tombent dans des excès qui n’ont plus rien à voir avec ces revendications légitimes. Il y a l’usage qui est fait des statistiques, et dans la même logique, une certaine facilité à tomber dans les généralités. Ironiquement, cette forme d’idiotie aide surtout à montrer en quoi celle d’en face, le féminisme contemporain radical, procède de la même manière pour faire valoir des revendications pourtant là encore souvent légitimes. La féministe, celle des suffragettes du début du XXᵉ siècle jusqu’à la babyboumeuse des trente glorieuses, avait encore à se battre pour faire valoir ses droits légitimes. Or, si certaines inégalités persistent, ou plus vraisemblablement des discriminations d’usage (inconscientes, dont les hommes comme les femmes sont responsables), l’égalité est un fait de droit acquis dans nos sociétés. Notre époque en cela, et il faut insister plus sur cela sans nier les efforts qu’il reste en permanence à faire (peut-être plus pour maintenir une intelligence, une vigilance, que pour acquérir de nouveaux droits), est probablement inédit dans l’histoire, et masculinisme comme féminisme apparaissent alors aujourd’hui comme des postures confortables et identifiables pour se plaindre de son sort quand il y aurait par ailleurs bien d’autres choses à changer dans le monde… Le syndrome du bien portant qui gémit que lui aussi il souffre. Pour gérer un tel syndrome, la mesure et la diplomatie sont requises. De la compassion, oui, comme ces masculinistes aimeraient en voir plus à leur attention, et comme l’auteure du film est prête à leur en donner, mais surtout un sens des priorités. Dans tous ces domaines, aucune véritable lutte n’est prioritaire aujourd’hui : des inégalités dont la société doit rester, oui, attentives, pour faire en sorte qu’elles se lissent mais dont le législateur ne pourra jamais rien sinon à promulguer des quotas. Les luttes véritables de notre temps sont ailleurs, et concernent là aussi les discriminations. Problèmes de riches. La Guerre des Rose, comme dans ce film où deux conjoints de la haute société passent leur temps à se chamailler. Souffrances et revendications légitimes, mais une goutte d’eau dans ce qui devrait régir nos sociétés (malheureusement trop enclins à réagir en fonction de ce qu’elles voient à travers le petit bout de la lorgnette, plus qu’à identifier des troubles réellement structurels).
Le film a ses défauts, inhérents à tout documentaire écrit à la première personne. C’est finalement cette approche, paradoxalement, qui le rend attachant. Peu importe si les activistes présentés (et de tous bords) ont des arguments ou des revendications légitimes, parce qu’on s’identifie bien plus à l’auteure du film. Il faut avouer qu’il est passionnant de la voir douter de ses propres convictions. À la Michael Moore, une fois qu’on a accepté l’absence totale d’objectivité, on peut s’amuser et louer la personnalité qui se dégage à travers ce qui ressemble peut-être plus à un journal filmé qu’à un documentaire. À la différence près que Cassie Jaye prend le risque de mettre à mal, en les mettant en scène, ses propres convictions. Une démarche peut-être maladroite, loin d’un Moore, mais fort louable. L’honnêteté, si ce n’est pas la raison, aura toujours ce petit air de sympathie qui fait qu’on pourra tout lui passer, en particulier l’imperfection.
La conclusion fait sourire : si Cassie Jaye a l’intelligence de renier des convictions dont elle se rend compte qu’elles étaient plus liées à une idéologie dont elle avait mal mesuré la portée qu’à des revendications légitimes, il faut avouer que la réaction qui en a été faite par la suite est à la fois ironique et prévisible. Car les reproches brutaux qui lui ont été faits à la sortie du film sonnent un peu comme : « Si tu n’es pas féministe, tu es forcément contre nous ». Vive la rhétorique bushienne, toujours efficace dans la bouche des fanatiques quels qu’ils soient, en particulier dans celle de ceux qui se donnent l’image de chevaliers blancs.

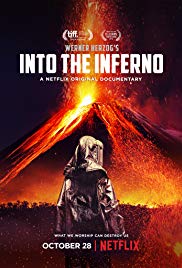






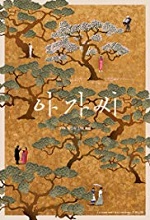 Année : 2016
Année : 2016





 Année : 2016
Année : 2016






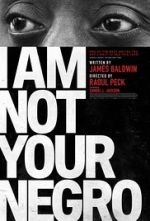 Année : 2016
Année : 2016












