La Grève, Ayn Rand (1957)
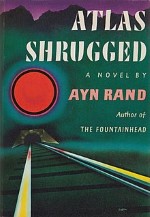
(Quelques notes)
« L’argent est un outil. L’argent est fondamentalement bon. C’est quand les corrupteurs utilisent l’argent non pour produire mais pour corrompre que l’argent cesse d’être l’outil du bien. »
OK. Mais alors pourquoi dire que l’argent est fondamentalement bon si, en tant qu’outil, il est utilisé pour corrompre ? Ça ne tient pas. Ou plutôt, ça ne tient pas si les corrupteurs sont toujours parmi ceux qui ne produisent pas et s’enrichissent sur le dos de ces “producteurs”. En l’occurrence, elle dénigre l’état populiste, comme seul capable d’organiser une telle corruption quand les entrepreneurs seraient par essence d’une probité sans failles.
C’est prendre un peu ses désirs pour la réalité. Et ça se dit philosophe avec des entraves avec la logique la plus élémentaire. On est en plein dans l’idéologie. Rand est capable de tordre la réalité pour la faire coïncider avec ses idées. Elle tire les conséquences avant de tirer les plans de sa pensée. Elle ne déduit pas, elle veut. Et toute sa démarche cherche à prendre l’allure de la rigueur, de la science, de la logique, de la rationalité, justement parce qu’elle en est dépourvue. Une arnaque. Pour elle, les anticapitalistes sont des pilleurs, des profiteurs, des escrocs n’ayant qu’un seul but : profiter des gens honnêtes et remarquables que sont les entrepreneurs ou les ingénieurs. Dans cette croyance niaise, l’entrepreneur et l’ingénieur, trouvent, ont du génie, parce qu’ils cherchent. L’ambition et le travail seraient toujours récompensés par le succès. Et le progrès, ce serait ça. C’est beau (et con) comme un conte de fées. Dès lors, ceux qui profitent, c’est toujours parce qu’ils ont renoncé au travail, par manque de génie ou de persévérance. Tu es pauvre ? Bien fait pour ta gueule parce que si tu voulais inventer le moteur à eau, tu pourrais ! Il suffit de vouloir ! Rand ne fait d’ailleurs qu’illustrer la bêtise de son propos avec des exemples techniques et scientifiques qui ne font que révéler son ignorance du sujet. C’est bien beau de se faire valoir de la logique, de la science, de la rationalité, quand on n’a pas les outils ou les moyens qu’on prétend avoir. Il faudrait la prendre aux mots, et la mettre au défi, d’inventer, de monter son entreprise. Si sa logique tient la route, elle devrait être capable de le mettre en application, seulement elle n’a aucune idée de ce dont elle parle. Le monde qu’elle dépeint n’existe seulement pas et n’est que le reflet de ses fantasmes.
Croire que le monde, son économie, puisse fonctionner selon des principes immuables, en toute indépendance, sans liens ni rapports avec des facteurs difficilement prévisibles et mesurables, que la raison puisse déceler tous les rouages d’un monde révélé à l’intelligence (celle de Rand), c’est bien du domaine de la croyance. Peut-être même du délire, et en tout cas, telle que présentée, cette philosophie est une vaste escroquerie.
Pourtant le monde continue de tourner en fonction de certains de ces principes foireux. Où est donc la logique dans tout ça, on se le demande… Même quand de telles idioties font la preuve de leur escroquerie, on ne remet pas en cause le modèle, on dit qu’on l’a mal appliqué, ou on l’adapte, randant encore plus caduque une logique qui ne tient la route, il faut le croire, que dans l’esprit de ceux qui y croient. Sur la grève, je me suis vu léviter…
Que les tenants de cette “philosophie” cessent donc de brandir la raison pour justifier leurs prétentions, parce que la “science”, elle par exemple sait tirer les conséquences de ses erreurs. Justement parce que le principe de la “science”, c’est de ne rien dire des mécanismes généraux du monde. La science « ne dit pas », elle constate, elle doute, se remet en permanence en question, et avance ainsi, en se contredisant sans cesse, petites touches par petites touches. Si des modèles sont conçus, c’est pour mieux appréhender ce qui a déjà été observé dans le monde ; et il suffit que notre regard se modifie, évolue, se fasse plus précis, pour que la science n’hésite pas alors à changer ses modèles ou en imaginer d’autres comme elle ne cesse d’ailleurs de le faire dans certains domaines où “elle” n’explique rien, mais observe en déclarant bien fort qu’elle ne comprend pas (encore). Rand elle n’a plus rien à découvrir ni à douter, puisqu’elle a déjà tout compris. C’est un Atlas aux pieds d’argile.
Rand ne pouvait d’ailleurs pas plus se tromper en cherchant à faire de son escroquerie une “science”. Parce que là où elle pense y voir le culte de l’individualisme, il y a en fait un travail coopératif qu’elle ne veut pas voir. L’idée d’un chercheur révolutionnant le monde dans son laboratoire… Eh bien non, la science, c’est avant tout la coopération. Une notion qui la fait peur parce qu’elle représente tout ce qu’elle exècre. Son savant (fou), s’il invente une machine destructrice, c’est bien parce qu’il l’aurait mis au profit d’un pouvoir… La science serait, comme l’économie, bienveillante et source de progrès quand elle est générée par des individus, et source de problèmes dès qu’elle serait ici de la coopération des hommes ?… Ce n’est pas de la philosophie et il y a là matière à se faire psychanalyser… Même s’il y a une part d’individualisme dans la science (à travers les parutions — non exemptes d’escroqueries par ailleurs), la connaissance, les usages, les applications qu’on fait de toutes ces avancées, n’est jamais phagocytée par une poignée d’individus. D’abord, la recherche scientifique œuvre pour le bien commun. Et la somme des connaissances peut encore être crédible et avoir une utilité pour le monde, parce que puisqu’il y aura toujours des individus qui chercheront à tirer à eux la couverture, tous les travaux, recherches, avancées techniques, doivent avant tout faire la preuve de ce qu’ils prétendent. L’individu, fort heureusement, ne vaut plus grand-chose face aux idées et aux applications bien réelles qui en découlent. La science n’est pas faite de prétentions, mais bien pleinement de réalisations.
L’économie (ou la philosophie randienne) n’est pas une science parce qu’elle ne peut simplement pas prendre en compte autant de facteurs entrant en jeu. L’idée d’environnement, d’où jailliraient des causes imprévues à tout un joli mécanisme bien pensé, est totalement exclue dans la représentation de l’économie pensée en tant que science. Prétendre le contraire est certes séduisant mais reste du domaine de la pseudoscience, de la pseudo-philosophie. Une arnaque, une croyance.
Anciennes notes trouvées dans un siphon à ordures quantiques :
« Vous n’aurez plus de pays à sauver si ses industries disparaissent. Vous pouvez sacrifier une jambe ou un bras, mais certainement pas sauver un corps en sacrifiant son cœur et son cerveau. »
C’est l’héroïne (entrepreneuse persécutée) qui s’adresse à quelques hommes influents de Washington (gouvernement “communiste”). En gros, Ayn Rand, c’est comme le Coran, on se demande si ceux qui l’ont en livre de chevet l’ont lu. La logique randienne est en tout cas magnifique. Ça tourne en circuit fermé. Tout est explicable et prévisible. Tout est rationnel (sic). « Oh merde, c’est quoi ça ? — Bah, ce sont des produits chinois. — Hein, c’est quoi la Chine ? Pourquoi on trouve ça ici ? — Bah, c’est moins cher. C’est ça le capitalisme. Si tu peux faire construire par les pauvres des autres, c’est encore moins cher. Du coup, il va falloir attendre que nos ouvriers retombent en dessous du niveau de vie des petits Chinois pour relancer l’industrie américaine. — Mais, mais !!! c’est pas logique !!! — Bah, si, c’est le capitalisme ma petite dame. Faut accepter les règles. — Mais, mais… ils sont communistes ! Et pendant ce temps, y a trois entrepreneurs cachés dans les Rocheuses qui font la grève parce que merde un gouvernement communiste, c’est trop injuste, et alors là ils vont voir si on fait la grève, le pays va s’écrouler. On dirait Jospin quand il arrête la politique. — Non mais là on va me demander de revenir non ? — Ah non. — Non mais, je suis parti là, je vous manque pas ? Vous n’avez pas besoin de moi ? — Non. — Bon, ben, d’accord, je m’en vais alors. — Salut. — Je suis parti. — Oui, oui. Si y a d’autres cerveaux pourris qui veulent se retirer du monde parce qu’ils se sentent persécutés et hautement indispensables à la société : tirez-vous. L’industrie se barre et les salaires des industriels grimpent, c’est ça la logique randienne. Qui sont les pillards, hein ? Booh.
« Je restitue aux riches qui produisent ce que les pauvres leur ont volé. »
C’est bon à savoir, dans le monde idéal de Rand, le libéralisme rend superflus les règles de sécurité obligeant les ouvriers par exemple à suivre des protocoles contraignants (pour leur productivité) imposés par ces pillards de bureaucrates. Parce que dans le monde de Rand, quand un accident survient, c’est le chef d’entreprise qui lâche son bureau et vient à la rescousse des ouvriers accidentés et qui règle le problème en un tour de vis et au mépris du danger. À quoi bon ériger des règles de sécurité quand on a Superman à la tête de l’entreprise ? Délire fascinant que Rand a en plus le toupet de nous vendre en prétendant promouvoir ainsi l’intelligence et la raison… L’esprit américain dans toute sa splendeur. Un rêve qui ne s’encombre jamais de réalité. De la poudre aux yeux. Il faut moins prouver qu’on est “intelligent”, que le répéter et le prétendre… Pour illustrer ça d’ailleurs, il y a l’anecdote savoureuse de Marjane Satrapi entendu l’autre jour à la radio. De passage aux États-Unis, elle rencontre une locale qui lui demande sérieusement si en Europe, la Lune est visible. Marjane Satrapi, un peu étonnée par la question et préférant ne pas s’éterniser en expliquant les mouvements des planètes, lui dit que non. Et l’autre lui rétorque alors qu’elle s’en doutait et que c’est pour ça que les États-Unis étaient le plus grand pays du monde. Sky is the limit…
— Voilà 100 pages que je cherche l’inventeur de ce moteur révolutionnaire à eau, savez-vous Professeur où je peux le trouver ? — Ah ça !… où est John Galt ! Mais vous avez parfaitement raison, cette théorie personnelle est tout à fait révolutionnaire ! Personne n’y avait jamais songé ! Bien sûr il manque 80 % des travaux de ce bonhomme, mais c’est fabuleux ! Quelle idée (personnelle) géniale ! Il faut le retrouver et savoir pourquoi il n’a pas poursuivi ses travaux pour le bien de l’humanité ?!! — C’est désespérant. Depuis que les collectivistes sont au pouvoir avons-nous vu de grands esprits scientifiques créer des théories révolutionnaires ? — Satanés marxistes qui sont un frein au progrès, vous avez raison. La science fait du surplace parce que les scientifiques ne peuvent travailler sur le moteur à eau… — Oui, et vous, vous y croyez à ce moteur, parce que vous êtes un grand professeur, et vous croyez en l’individualisme, n’est-ce pas ? — Bien sûr. Je peux même me vanter de n’avoir jamais fait le moindre geste pour les individus de peu de valeur qui vivent au crochet de ceux qui œuvrent pour leurs biens personnels. L’égoïsme, miss Taggart, il n’y a que ça de vrai ! — Oh, professeur !… — On baise ? — Oh oui professeur, entre génies, on se comprend. — Nous allons mélanger nos fluides corporels et réinventer le moteur à eau ! — Oh oui, continuez professeur…
— Salut, il est super bon votre hamburger, pourquoi vous ne viendriez pas à New York, je vous embauche, je suis pleine aux as, et je peux me permettre quelques caprices : je vous offre 10 000 dollars par semaine pour être mon cuisinier personnel. — Heu, non. — Comment ? Mais vous n’avez pas d’ambition ? Comment un homme aussi talentueux que vous peut ne pas avoir d’ambition ? — Je suis ici pour une raison précise, miss Taggart. — Comment connaissez-vous mon nom ? — Qui est John Galt ?… — Arrêtez de plaisanter ! Vous n’avez donc aucune ambition ? — Je suis ici parce que je ne veux pas travailler pour la collectivité. Mon nom est Sigmund Freud, je suis psychanalyste, meilleur ouvrier de France, inventeur de la sodomie statique et donc propriétaire de ce snack au milieu de nulle part. — Sigmund Freud, le grand Sigmund Freud ?! Mais c’est horrible ! Et tout ça à cause des collectivistes ! — Mes travaux révolutionnaires ne cessaient d’être mis à l’épreuve par des gens malintentionnés, c’était pénible, alors je suis parti. — Bon, sinon, vous ne voulez pas venir à New York avec moi ? Vous faites de putains de hamburger pour un psychanalyste. Normal vous me direz, quand on est un génie, on peut toucher à tout. D’ailleurs à ce propos, vous ne sauriez pas où je peux trouver l’inventeur du moteur à eau ? — Un moteur à eau ?! comme c’est original ! Cela devrait sauver le monde si cette invention voyait le jour ! mais je doute que les collectivistes laissent le génie qui l’a inventé le livrer à l’humanité, ce serait trop dangereux pour eux ! — On est d’accord. — Vous voulez que je vous montre mon moteur à sodomie statique ? — D’accord, mais sans oignons. — Ne vous inquiétez pas, mes moteurs produisent les meilleures sodomies statiques d’Amérique (donc du monde) et c’est garanti sans oignons.
J’ai lu que certains considéraient qu’elle n’avait aucun style. C’est justement l’absence de style (du moins ce qui en transparaît à la traduction) qui m’intéresse au contraire. Comme dans beaucoup de romans us, je pense que l’écriture est moins portée sur le style que sur l’évocation des choses et des idées. Le récit (même si elle a l’art de délayer un max, ce qui est plutôt agaçant) est bien tenu, la mise en scène est directe et efficace, et les descriptions psychologiques sont à mon sens très justes. Ici, peu importe le style, mais bien ce qui est rapporté. C’est écrit comme un bon roman de gare quoi… Et traduction ou pas, je ne pense pas que ce soit si facile que ça. Quand le style est trop lourd, trop foisonnant, ça devient vite indigeste (bon là c’est « l’idéologie » et les répétitions, la longueur, qui sont insupportables…). Je ne suis pas un grand lecteur, ceci pouvant expliquer cela.
Le côté dystopique, je pense qu’il est en filigrane pendant un moment, parce qu’on adopte le point de vue de l’héroïne, qui elle n’a aucune idée de ce qui se trame. Elle s’agace juste de la manière dont tournent les choses sans savoir ce qui se trame derrière (tin en y passant, c’est le schéma de pas mal d’histoire us, où un personnage seul se trouve mit face à la bêtise du “groupe”, viens de voir Zero Dark pointé et c’est tout à fait ça…), et ne trouve qu’un soutien dans les bras de l’autre génie iconoclaste inventeur, lui, des rails Carambar sur lesquels l’inévitable monstre gouvernemental vient lorgner. Plus que de la naïveté, j’y vois surtout des fils à papa qui arrivent avec leurs certitudes et leurs prétentions, comme si, sachant tout sur tout, ils étaient les seuls à même de décider de tout jusqu’au prix de la mayonnaise à la cafétéria… Le mythe de l’entrepreneur tellement génial et impliqué, que son pseudo-perfectionnisme est la raison de son succès. C’est pas naïf, c’est super con. Surtout qu’elle applique cette “philosophie” à tout, notamment à la science en regardant ça de loin (et pour le coup, oui, ça c’est naïf… dire « oh merde, mais il n’y a pas eu de successeur à Einstein donc la science fait du surplace… » Sa dystopie à elle, ce serait de voir une science sans personnalité pour défendre les avancées bien réelles, c’est une bourse sans entrepreneur star… C’est assez affligeant comme vision du monde. Et surtout ériger ça en “philosophie” c’est d’une bêtise…). Donc je te rassure, les personnages ne deviennent pas plus sympathiques par la suite^. (Je ne sais même pas si j’arriverais à le finir…)


















