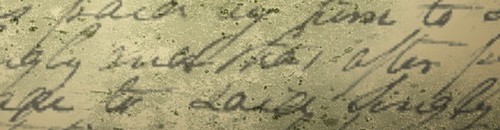Evolution des usages dans le cinéma américain visant à filmer une séquence mettant en scène des acteurs placés dans un véhicule en marche
Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9
Table :
Les films en noir et blanc avant la couleur (du cinéma muet aux années de guerre) : le règne de la transparence
- Avant la transparence, on improvise
- La transparence, solution de facilité (on se replie dans les studios)
- Focus sur le début des années 40 avec le basculement progressif vers le film noir et l’occasion manquée d’un cinéma résolument réaliste tourné en extérieurs
Intermède : le néoréalisme
Les films en noir et blanc d’après-guerre (1945-1955) : hésitations, tâtonnement et entêtements
- Les limites du procédé dans les productions d’après-guerre
- La révolution éphémère et inachevée de Gun Crazy
- L’étrange cas de la motocyclette
- L’ère de la modernité et prémices lointaine du Nouvel Hollywood
- Le paradoxe Sabrina
Milieu des années 50 : séries A ou séries B, grosses productions ou petites et moyennes productions, drame ou cinéma de genre, cinéma en couleurs ou en noir et blanc
- La transparence face au défi de la couleur
- La nouvelle approche réaliste dans le film noir
- C’est dans les plus gros pots qu’on voit les meilleures voitures (l’exemple de Ben-Hur)
Fin des années 50, début des années 60 : incohérences & innovations à l’heure des nouvelles vagues européennes
1967-1969, le Nouvel Hollywood : révolution des usages & fin progressive des transparences à l’ancienne
——————– Quatrième partie ——————–
Fin des années 50, début des années 60 : incohérences & innovations à l’heure des nouvelles vagues européennes
Les grosses productions en couleurs ne s’encombrent toujours pas de cohérence et de réalisme, les transparences sont donc toujours à la fête (comédies, romances, films d’Hitchcock, films tournés en Europe mettant Audrey Hepburn en vedette, etc., le procédé ne dérange personne alors qu’il apparaît de plus en plus démodé). Mais dans les productions en noir et blanc, souvent plus réalistes, même à gros budget, on tente quelques approches qui ne vont jamais jusqu’au bout de la logique en inventant et généralisant des dispositifs permettant de filmer sur les routes.
Faire les choses à moitié
Face à la menace de la télévision, de nombreuses productions partent filmer en extérieurs. Le public aime voir des espaces exotiques, des personnages en voyages, sur les routes. On mêle alors souvent le pire et le meilleur. Sachant qu’on peut désormais placer sans mal une caméra à l’arrière d’un véhicule, on profite de se trouver sur place pour le faire. Mais quand il s’agit de proposer un contrechamp, on retourne bien souvent aux vieilles habitudes : les transparences.
Meurtre sous contrat (Irving Lerner, 1958)
En 1958, dans les petites productions, on semble parfois tiraillés entre les possibilités offertes par la technique et les habitudes de production à l’esthétique éprouvée. Placer une petite caméra à l’arrière d’un véhicule, on l’a vu, cela est devenu assez monnaie courante dans les années 50. Mais aller au bout de la logique et comprendre que cela implique une cohérence esthétique, on n’y est pas encore totalement. Et surtout, même si on s’en rendait compte, non seulement l’usage nous ramènerait encore à de vieilles manières de produire et représenter des séquences prenant place dans une voiture, mais on ne saura tout bonnement pas comment faire pour réaliser d’autres plans : ceux réalisés avec les conducteurs et passagers filmés de face.



(Je passe le nombre de transparences invraisemblables qui jalonnent le film. Le film est un chef-d’œuvre, mais il n’a certainement pas révolutionné l’histoire de la production d’un film.)
Bonjour tristesse (Otto Preminger, 1958)
Filmé en France, le film ne s’embarrasse pas pour autant de quelques transparences d’assez mauvais effet. Dans son introduction, toutefois, on peut remarquer une tentative de travelling d’accompagnement de l’automobile conduite dans la capitale filmée par l’avant depuis un autre véhicule. La séquence est montée en alternant plans filmés sur place et plans filmés avec transparence. Le manque de cohérence n’est rien face au changement de couleurs dans le film. L’ironie surtout du film, c’est que la conductrice n’est autre que Jean Seberg. Deux ans plus tard, Jean-Luc Godard la filmera au même endroit, à peu près dans la même situation, et sans transparence (essentiellement pour jouer avec des jump cuts).


The Lineup (Don Siegel, 1958)
Malgré une volonté évidente chez Siegel de pousser le réalisme aux limites du possible et du spectaculaire, il échoue à proposer autre chose dans ses séquences de course-poursuite qu’un assemblage de plans filmés sur place et transparences. Lui qui avait brillamment réalisé Ça commence à Vera Cruz en faisant parfois oublier les transparences en filmant une décapotable sur des roues désertes, il se heurte ici au même écueil qu’il avait rencontré pour la course-poursuite de son film tourné en 1949 : filmer une voiture dans des situations périlleuses devient impossible si on souhaite le faire sur la route, surtout quand on a comme ici cinq personnes dans le véhicule, dont une enfant. Ce n’est que dans un plan de sa première séquence que Siegel arrive à placer sa caméra là où on n’imagine pas encore pouvoir la placer ailleurs : sur la banquette arrière. Dix ans plus tard, dans la même ville, San Francisco, c’est un réalisateur britannique, Peter Yates, qui réussira avec Bullitt là où Siegel avait échoué.





Le Coup de l’escalier (Robert Wise, 1959)
Sept ans après La Ville enchaînée qui reprenait les expérimentations de Gun Crazy en évitant de tourner le moindre plan en studio, Robert Wise adopte ici une approche résolument réaliste (voire naturaliste) en choisissant de filmer une majeure partie de son film en extérieurs comme c’est devenu presque la règle dans les films criminels (convient-il encore de qualifier tout à fait de « films noirs » ces films adoptant une approche réaliste ?) depuis 1955 avec En quatrième vitesse et Les Inconnus dans la ville. Reste la question de la manière de filmer ces séquences prenant place dans un véhicule. Robert Wise ici alterne le très bon et le moins bon. Débarrassé de dialogue, quand Robert Ryan se retrouve seul au volant, on y voit que du feu. Quand il place sa caméra à l’arrière et filme la route et les deux personnages au premier plan, la séquence semble bien avoir été filmée sur la route. Quand il fait croiser deux personnages, l’un dans une automobile, l’autre dans un bus, il place sa caméra dans le bus, aucune raison ici de passer par une transparence. Mais quand il convient alors de faire interagir deux acteurs, le charme n’opère plus et on devine assez facilement que Wise a dû avoir recours à une transparence qui jure forcément avec l’esthétique générale du film.




Psychose (Alfred Hitchcock, 1960)
On sait que Hitchcock est attaché aux transparences et qu’il se soucie peu de réalisme, mais Psychose est un laboratoire pour lui. Il retourne au noir et blanc et dit avoir adopté des techniques de réalisation rapides issues de la télévision. On voit peut-être cette volonté de filmer autrement quand le cinéaste filme la rue (bien que ce ne soit pas si rare chez lui). Avant d’arriver à l’hôtel, Marion Crane passe un bon moment dans son véhicule, seule, à rouler sur les routes. Hitchcock alterne alors les plans tournés en extérieur (voire dans le véhicule pour simuler une vue subjective du personnage regardant la route) avec des plans fameux de l’actrice tournés en studio. Pour certains spectateurs dont je suis, ces images surprenantes de transparences constituent leur première expérience avec le procédé. Le mélange est étonnant, mais on peut arguer que l’effet produit sert aussi à augmenter l’impression d’isolement du personnage.


Jugement à Nuremberg (Stanley Kramer, 1961)
Malgré un sens indéniable pour les sujets sérieux et le réalisme, comme les autres, Kramer est prisonnier d’une forme d’incohérence qui le pousse à chercher à introduire des prises de vue bien réelles captées depuis un véhicule en mouvement tout en les mariant avec d’autres prises de vue cette fois réalisées en studio avec ses vedettes assises sur une banquette factice et devant une transparence. Pour situer et contextualiser son film, le réalisateur choisit d’introduire son film avec une sorte de vue d’ensemble de la ville bombardée par les alliés dans laquelle la voiture du juge se fraie un chemin. Mix épouvantable.



Les Nerfs à vif (J. Lee Thompson, 1962)
Déjà confronté à la question de la représentation de l’intérieur d’un véhicule en marche dans Ice Cold in Alex, J. Lee Thompson se retrouve placé face au même défit en allant réaliser des films à Hollywood. Sans toutefois aller jusqu’au bout d’une logique réaliste. On le voit ainsi multiplier les séquences en extérieurs, parfois même à l’intérieur d’un véhicule à l’arrêt, et propose un plan avec une caméra située sur la banquette arrière alors que la voiture roule. Belle initiative. Mais dans une autre séquence, dialoguée cette fois, le réalisateur britannique adopte la transparence.





Carnival of Souls (Herk Harvey, 1962)
C’est encore dans les productions indépendantes que les réalisateurs se hasardent à tourner le plus possible en extérieurs et se permettent quelques audaces en filmant sur la route. Les routes de campagne aident alors à cette fantaisie. Mais encore une fois, on ne fait que reproduire les usages passés et se retrouver tout à coup prisonnier de la bonne vieille transparence quand il faut proposer un plan de face d’un acteur conduisant un véhicule en mouvement.
Carnivals of Souls est une sorte de road movie fantôme et macabre. Herk Harvey tourne d’abord sur un pont en multipliant les plans en extérieurs : travelling arrière d’accompagnement sur deux véhicules roulant côte à côte sur le pont, vue derrière la conductrice d’une des automobiles, vue depuis le siège passager avant du véhicule à l’arrêt, puis une multitude de vues subjectives avec lesquelles Harvey évite soigneusement le contrechamp. Harvey reprend même l’idée de filmer un véhicule en mouvement depuis un autre (L’Ennemi public, 1931). Le réalisme des plans est jusque-là confondant. Enfin, Herk Harvey n’a d’autre choix qu’opter pour les transparences pour les quelques plans de face ou de côté avec l’actrice au volant.










Seuls sont les indomptés (David Miller, 1962)
Réaliser un western moderne dans lequel le cheval côtoie automobiles, camion et même hélicoptère n’a rien d’évident. Pourtant, David Miller ne pourrait pas s’y prendre mieux. Les westerns sont habituellement tournés en extérieurs avec plus ou moins de séquences tournées en studio. Il serait compliqué de faire autrement dans un western moderne. Certains plans, dans d’autres circonstances auraient bénéficié de transparences, mais Miller arrive, avec une certaine réussite, à filmer une jeep sur les routes escarpées d’un désert. On dispose également de plans en vue subjective tournés depuis l’hélicoptère, ainsi que de plans en travelling d’accompagnement sur un camion (la caméra est forcément disposée dans un véhicule conduisant à sens inverse, obligeant une privatisation de la voie publique). En revanche, impossible de proposer une vue réelle pour les plans rapprochés sur les acteurs dans l’hélicoptère, mais la transparence est parfaite. Ce qui n’est pas le cas d’une autre transparence, quand Miller montre tout d’un coup le couple de policier conduisant la jeep de face. Il en fallait d’un rien, mais le réalisme général dégagé par le film est surprenant.





Le Plus Sauvage d’entre tous (Martin Ritt, 1963)
À l’image de Seuls sont les indomptés, Le Plus Sauvage d’entre tous est un western contemporain. De ce fait, le film est principalement tourné en extérieur, et les chevaux y sont volontiers troqués pour des automobiles. Comment représenter alors les séquences prenant place dans une auto ? D’abord, en limitant les séquences dialoguées. Martin Ritt s’en moque. Autre possibilité : filmer de dos en plaçant la caméra à l’arrière du véhicule. C’est difficilement tenable pour des séquences dialoguées, et Ritt n’utilise que brièvement un tel plan sur une voie privée. Le film a beau avoir une patte réaliste, le film ne nous épargne pas deux ou trois séquences dialoguées tournées en studio avec des transparences. Le véhicule roule à toute berzingue, mais les personnages semblent posés sur un tapis volant, à l’abri des éléments extérieurs. Filmer en nuit artificielle n’y changera rien. À deux doigts d’inventer la remorque et d’y poser un véhicule. On n’y est pas encore, mais cela devient de plus en plus nécessaire : l’écart entre les types de plans tournés en studio et ceux filmés sur place se fait de plus en plus évident.




Un monde fou, fou, fou, fou (Stanley Kramer 1963)
L’intrigue se passe une majeure partie du temps sur la route, mais on frise plutôt la fantaisie : les transparences font mal aux yeux, et le film annonce sans doute plus les aventures de La Coccinelle que le Nouvel Hollywood. Pourtant, dans la scène introductive, en plus des quelques plans tournés en hélicoptère pour filmer la poursuite, un autre semble avoir été tourné sur la route, probablement conduit par un cascadeur. La transparence qui suit immédiatement après ne fait que renforcer l’énorme écart entre les plans tournés sur place et ceux confectionnés en studio.





Une certaine rencontre (Robert Mulligan, 1963)
Grosse production indépendante (Pakula & Mulligan) en noir et blanc sur un sujet sensible. Réalisme recherché, beaucoup d’extérieurs en ville face à des intérieurs probablement tournés en studio. Un mix inévitable à l’époque. On pourrait craindre le pire, mais Mulligan évite d’abord les séquences à l’intérieur d’un véhicule, et dans l’unique séquence avec trois personnages dans un camion, il ne s’en tire pas trop mal. Le véhicule reste dans le trafic et la transparence est parfaite. Paradoxalement, le gros plan de Nathalie Wood fait plus « studio » alors même qu’il n’a pas besoin de transparence (dix ans plus tard, on ne manquera pas d’y ajouter une vitre et d’éviter au moins les plans trop de face cassant inévitablement le quatrième mur).

À bout portant (Don Siegel, 1964)
On retrouve souvent des films de Don Siegel dans cet article, signe qu’il avait une passion pour les histoires de routes, les poursuites, les automobiles… Ses choix, en revanche, ne sont pas forcément toujours cohérents. Réaliser un film avec plein d’action et de course poursuite, c’est une chose, pouvoir les réaliser en est une autre. Prisonnier des innovations vieilles depuis maintenant plusieurs années, il se contente de les reproduire, tout en ayant recours massivement aux transparences quand il se trouve face à l’impossibilité de les réaliser en extérieur. Les nombreuses scènes dialoguées dans un véhicule, ainsi que la couleur, n’aident pas à sortir des écueils auxquels trop de films tombent allégrement à l’époque. Pour un néo-noir, on serait en droit d’attendre autre chose qu’un assemblage incohérent entre vues prises depuis la banquette arrière, travellings d’accompagnement de face ou en hélicoptère mêlé à des transparences peu vraisemblables. Siegel laisse les prochaines innovations à d’autres.









À titre de comparaison, la même année, Philippe de Broca tourne L’Homme de Rio sans la moindre transparence.



La Poursuite impitoyable (Arthur Penn, 1966)
Arthur Penn réalisera un des films que les historiens considéreront comme un des jalons du Nouvel Hollywood l’année suivante (Bonnie and Clyde) ; beaucoup d’aspects de cette « nouvelle vague » apparaissaient déjà dans Miracle en Alabama (notamment dans le montage) ; et avec La Poursuite impitoyable, Arthur Penn confirme son goût pour le réalisme dans une grosse production. Le film bénéficie de nombreux extérieurs et semble perdu entre deux époques, à jongler souvent entre des usages (souvent du western) passés et futurs. On le voit ainsi proposer un dispositif permettant de filmer un vieux véhicule décapotable sur la route, filmer à l’intérieur d’un train… tout en retombant dans le travers des transparences quand il devient nécessaire de filmer des séquences dans un véhicule de police avec sa star. L’incohérence finit par se voir, mais ce n’est pas Arthur Penn qui innovera en la matière (Bonnie and Clyde, aussi réaliste soit-il, ne se privera pas des transparences).



La suite, page 8 :