Notre nazi est de ces films dont il est impossible de dire s’ils nous ont plus ou non et qui pour autant sont loin de nous laisser indifférents. Plus qu’une expérience cinématographique, sa vision en devient presque un acte historique, intellectuel, politique… avorté. On voudrait y chercher un sens, force est de constater qu’il n’y en a aucun. Son réalisateur, embarqué par un autre pour suivre le tournage de son film (sorte de making-of avant l’heure), n’est que le témoin d’un événement étrange, fou, un acte de réalisation un peu dingue derrière lequel se cachent d’étranges objectifs. Même si tout cela est bien rendu par le montage, si Robert Kramer se cache généralement assez bien derrière son sujet, il n’en reste pas moins que ce dont il est le témoin, retransmis, on peut le croire, assez fidèlement à ce qu’il a pu voir, plus que du cinéma documentaire, c’est du reportage ou une chronique d’un de ces moments rares où plus rien n’a de sens, où tout semble partir en sucette et où personne ne contrôle plus rien. Robert Kramer n’avait sans doute aucune idée de ce dans quoi il mettait les pieds, on peut donc difficilement chercher dans son film une quelconque intentionnalité de cinéaste. Ce qu’on y voit, c’est ce qu’on juge, ou essaie de juger, pas le film même. L’événement dépasse le film et son réalisateur. Ses réalisateurs. Et peut-être aussi beaucoup ses spectateurs.
Pour comprendre le niveau de surréalisme et de malaise atteint par le film, il me faut évoquer ce qui s’y joue. Le langage, avec sa distance, est probablement plus apte à en faire ressortir l’absurdité…
Un cinéaste sans nom, ou presque, Thomas Harlan, s’apprête à réaliser un film dans lequel on apprend vaguement qu’une sorte de retournement de l’histoire y est proposé, car un petit groupe de militants y séquestrerait un ancien nazi pour l’interroger sur ses crimes… Or, et c’est le premier faux pas du film (filmé) qui entraînera tous les autres, le rôle joué par le nazi est précisément joué, et en connaissance de cause parce qu’il a été précisément été choisi pour ça, par un criminel de guerre nazi, reconnu comme tel par un tribunal, ayant passé des années en prison, et relâché pour cause de maladie (ce n’est plus qu’un vieil homme inspirant parfois la sympathie avec ses « bonnes manières » comme dira Harlan, et il a toute sa tête — du moins, on voudrait le penser, la suite permet de penser qu’il est sans doute presque autant fêlé que celui qui l’a appelé pour réaliser son film). En vue de ce magnifique projet autonauséabond, Harlan convoque son homologue américain, Robert Kramer (surtout connu pour le film qu’il tournera plus tard, Route One USA) pour produire un film sur son film, dans son film, sur le plateau… Quand un projet n’est pas simple, il a raison, autant se compliquer encore plus la tâche.
Si Thomas Harlan est un inconnu aux yeux de l’histoire du cinéma, son nom ne l’est pas tout à fait, puisque c’est celui du réalisateur du film de propagande nazie le plus connu : Le Juif Suss. Thomas Harlan est le fils de Veit Harlan. Cigarette à la main, intellectuel investi et volubile, Harlan explique face caméra la différence entre un criminel de guerre comme Filbert (le vieux SS, acteur principal de son film) qui a toujours cherché à minimiser ses crimes, et son père, fort sympathique selon lui (ce qui est presque un crime à ses yeux dans les circonstances de l’époque… — bonjour Docteur Freud), ayant réalisé ses films durant la guerre en parfait ingénu, et relaxé après-guerre par les tribunaux chargés de juger de son niveau de responsabilité, dirigés selon lui, même, par un ancien criminel de guerre… On a un peu comme l’impression de voir un petit enfant ayant souffert du sort de son père (tout à la fois justifié à ses yeux et injuste : il a souffert de toute évidence de savoir qui a été son père, mais bien plus encore semble-t-il que ce même père semblait n’avoir aucun remords de ce passé…, la schizophrénie n’est pas loin) et qui chercherait en vain à pointer du doigt un « vrai méchant » pour le livrer aux chiens de la bien-pensance d’une Allemagne honteuse de son passé.
Le tournage commence. Le montage de Kramer est un peu agaçant à se focaliser surtout sur la forme au détriment de son sujet : on comprend mal l’objet du tournage, parfois les situations sont confuses, il capture et rend des déclarations qui, sorties de leur contexte, n’ont pas beaucoup de sens, ou qui au contraire, en prennent peut-être un peu trop. Ça part ainsi dans tous les sens, et autant le cinéaste qu’on voit filmer que celui témoin du tournage de l’autre, aucun ne semble savoir ce qu’il fait. L’improvisation semble permanente. On interroge les techniciens, leur malaise parfois, ou au contraire la sympathie non feinte qu’ils peuvent avoir pour le vieil homme. Kramer filme Filbert quand Harlan filme Filbert, si bien qu’on a du mal à savoir ce qui tient parfois de la répétition et du film (de Harlan — qu’il serait par conséquent intéressant de voir pour se faire une idée…, puisqu’il existe). Les répliques semblent n’avoir souvent aucun sens. Harlan fait dire n’importe quoi à son acteur SS qui se laisse manipuler sans peine. Filbert se casse la gueule et manque de se fracasser la tête contre une table, se relève penaud sans rien dire, des membres de l’équipe courent à son aide, Harlan fulmine, et on continue le tournage comme si de rien était… À ce moment, on est nous-mêmes en tant que spectateurs, partagés entre ce qu’on sait de ce vieux bonhomme, de ses crimes reconnus, de sa peine purgée, et de son air hagard, encore lucide, mais qui manifestement cherche à garder un semblant de dignité face à une équipe de tournage ne sachant pas bien comment le prendre… On guette un peu le moment où, face à une déclaration, on pourra enfin le haïr, juger. On reste aux aguets en prenant soin de ne pas se laisser prendre par son air de chien battu, son absence totale de haine ou de mépris à l’égard de ceux qui connaissent ses crimes…
Et puis Harlan a une idée. Kramer le film en possession de documents que le fils de l’ancien réalisateur du régime nazi présente comme des preuves de nouveaux crimes commandités par l’ancien SS et acteur de son film, et pour lesquels il n’aurait pas été jugé. Malaise. Où est la limite entre la fiction, la réalité et un tribunal improvisé… ? Harlan garde tout ça sous le coude et prépare sa revanche, son coup de théâtre foireux, sans en dire ou en montrer beaucoup plus encore à ce moment à Kramer qui continue de filmer le tournage innocemment.
Un peu ignorant et mal à l’aise avec l’opinion qu’ont de lui les techniciens présents sur le plateau, Filbert se rapproche de cet autre curieux personnage qui filme en même temps que l’autre, et qui, sans doute à ce moment, un peu en délicatesse avec son réalisateur, cherche un peu d’appui ou de réconfort, auprès d’un autre. La réponse de Kramer alors, pleine d’innocence toujours, belle et naïve comme celle que pourrait avoir un lycéen dans cette position, mais peut-être aussi la seule possible, la plus saine, la plus « étrangement logique » au milieu de ce qui ne peut l’être : « Je pense que vous êtes un dangereux criminel. Vous avez été jugé pour vos crimes. Je n’ai aucun respect pour vous. Mais c’est vrai, en même temps, vous êtes vieux et vous me faites un peu de peine. » (Je paraphrase.) La logique schizophrène du « en même temps », déjà. Le vieux bonhomme, qui attendait de toute évidence une consolation aux interrogatoires qu’on lui faisait subir dans la fiction et en coulisses depuis le début du tournage, remercie outré le cinéaste pour son honnêteté et se barre. « Vous me reprochez des crimes qu’on m’a obligé de faire ! » Malaise.
La suite n’est pas moins édifiante. Alors que Harlan tente de sortir les vers du nez de son officier SS mélangeant outrageusement le réel et la fiction, celui-ci se laisse aller à quelques confidences lui arrachant quelques larmes. Personne n’y comprend rien : rappelons que le tournage s’effectue en langue allemande, que l’acteur (sa jeune interprète) et le réalisateur parlent allemand, le reste de l’équipe est français sans parler un mot d’allemand, et le cinéaste chargé de réaliser le film sur le film est Américain francophone. La confusion est totale sur le plateau, et Kramer (réalisant un film en vidéo en français, puisque les inscriptions sont en français) pousse la confusion jusqu’à ne jamais traduire les nombreux passages en allemand par la suite (la Cinémathèque a eu la bonne idée, elle, de nous sous-titrer le tout en anglais pour au moins disposer de ces traductions, mais en travestissant « l’œuvre » de Kramer, en quelque sorte, volontairement plus confuse). Un petit comité se forme alors, et le cinéaste, fils du bon élève Harlan, fait la leçon à son équipe en leur expliquant la situation : selon lui, et ils ne devraient pas s’y tromper, les larmes de ce criminel, si elles ne sont pas feintes, ne sont aucunement la conséquence de tardifs remords pour les crimes commis par un officier SS, mais les pitoyables larmes d’un homme regrettant que les maladresses politiques de son frère lui aient interdit toute promotion dans le régime nazi. Merci professeur pour ces explications, mais même avec la traduction, et tel que c’est monté par Kramer, on peut douter de cette interprétation. Et quand bien même ce vieillard pleurerait sur son sort passé, les petits commentaires putrides qui viennent à sa suite sont du plus mauvais effet. L’ostracisme froidement délibéré, bêtement complotiste qu’on adresse à un plus faible que soi et qu’on accuse des vétilles pour expliquer les maux de la terre, ça commence comme ça. Un criminel de guerre pleure l’arrêt brutal de sa carrière, la mort de son frère, l’ostracisme très relatif de ses proches dans les hautes sphères du nazisme… La belle affaire. Il a déjà été reconnu par un tribunal que c’était un fils de pute, s’émouvoir de telles futilités laisse assez songeur sur le sens des priorités de ceux, coupables, d’un tel débinage. Agir en connard envers un autre connard ne te rend pas meilleur que lui. Tu lui apportes même malgré toi un peu de légitimité : entre connards, le criminel sera toujours le plus fort. Il faut donc laisser les criminels à leur place et éviter de chercher à leur tailler un costard, c’est à la société de le faire, pas aux petits tribunaux improvisés sur des plateaux de cinéma…
Arrive le clou du spectacle, la petite manigance fomenté par Harlan pour agiter de moisi ce qu’il y a encore de vivant dans ce bocal au formol. Harlan sort son papier qu’il présente comme une preuve devant l’ancien officier SS de crimes pour lesquels il n’aurait pas été jugé. Filbert fait ce que tout criminel de guerre fait dans cette situation (ou plutôt face à un vrai tribunal) : il nie. Seulement, ce n’est pas tout, loin de vouloir seulement mettre Filbert face à ses responsabilités en lui présentant des documents comme des preuves de ses crimes, Harlan lui impose en plus la confrontation avec deux hommes supposés survivants d’un de ses massacres. C’en est trop pour l’ancien SS, il cherche à quitter le plateau, mais le réalisateur l’en empêche, pointe sur lui sa caméra (Kramer en fait autant), s’ensuit une bousculade qui frise le harcèlement et le lynchage. On déplume Filbert de sa perruque, il se retrouve à moitié nu, et on l’abreuve de questions qui n’ont évidemment plus aucun rapport avec du cinéma. Cut. Kramer nous raconte, un poil cynique, la suite : le tournage a continué, et le film a pu se faire, l’acteur dira même par la suite que ce film aura été indéniablement le plus grand événement de sa vie…
Surréaliste.
















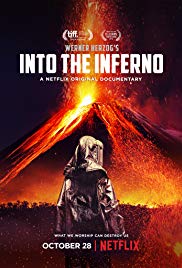

 Année : 2010
Année : 2010








