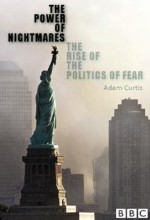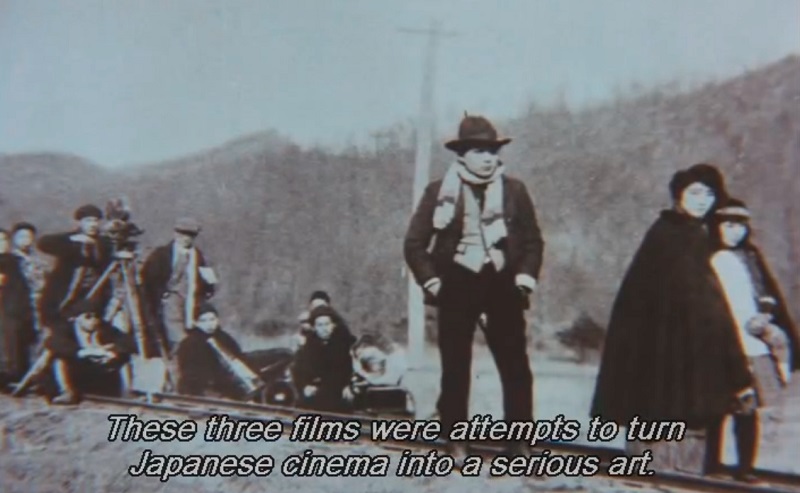La mise en abîme n’est pas nouvelle au cinéma. Alice Guy ou Léonce Perret s’y étaient essayés les premiers. Vous ne trouverez donc rien d’original dans le fait de filmer un film sur un film. Et, soit dit en passant, l’originalité n’existe pas : les vaines tentatives de faire dans l’originalité n’ont jamais rien produit de bon (à moins de proposer autre chose, volontairement ou non).
Ce qui captive en revanche dans ce film entre documentaire et expérimentation, comme dans sans doute la grande majorité d’entre eux, c’est son développement. Greaves part avec une idée : tourner des essais avec des acteurs avec un vague concept de quête de la « réalité » (le cinéma, contrairement à ce que certains ont prétendu, n’est ni la vie ni la réalité), et avec l’ambition peut-être de se muer en anthropologue ou en sociologue des plateaux. Finalement, on ne se sera jamais sans doute autant rapprochés de ce qu’est la vérité sur grand écran.
Les premières minutes du montage que Greaves voudra bien nous laisser voir (le montage reste une forme de sémantique cinématographique déjà très éloignée de la réalité) se montrent peu flatteuses pour les acteurs ainsi exposés aux expérimentations du cinéaste : Greaves semble avoir donné quelques lignes de dialogues bidon aux interprètes. (Enfin, pas tout à fait, parce qu’il prétend avoir choisi un sujet (la sexualité), censé éveiller l’intérêt du spectateur.) Et précisément, le même constat que lui peut être fait : le cinéma possède bien une certaine facilité à s’écarter de la « réalité ». On se balade à Central Park, quoi de mieux que des décors naturels pour se mettre en quête d’authenticité ? Le problème, c’est que Greaves a volontairement forcé le trait avec un texte pitoyable de médiocrité. Les interprètes s’avèrent pires encore. Et l’on entend déjà les critiques fuser de toutes parts hors ou dans le champ.
Les acteurs changent, ce n’est pas beaucoup mieux. Greaves nous dévoile sa méthode : une première caméra filme les acteurs, une autre pointe en direction des techniciens et des acteurs et une troisième se charge de capturer les à-côtés, les imprévus ou tout ce petit monde de loin (effet de distanciation garanti qui répond surtout à l’ambition de montrer l’évolution d’un groupe de personnes, d’une société, pensant être réunis dans le but de produire un travail commun). Au montage, il use parfois d’écrans fragmentés (split screens) pour laisser apparaître la simultanéité de son dispositif et des rapports constants entre ce qui se passe à l’intérieur de ce qui est censé constituer le « champ » de l’action d’un film et les coulisses.

Un cinéaste facétieux
Greaves fait mine d’être perdu, le tournage est sans cesse interrompu (ou presque, puisque c’est filmé, et ce sont bien ces instants imprévisibles que le cinéaste cherche à provoquer). Personne sur le plateau ne comprend où il les mène. Peut-être sont-ils naïfs ou bien briefés à l’insu de leur plein gré, quoi qu’il en soit, ces moments de flottement et d’incertitude est précisément ce que le cinéaste compte voir émerger de son dispositif. En réalité, il est peut-être le seul à jouer dans son propre film (à se jouer de tous même), les autres n’ont pas conscience qu’ils ne jouent pas le rôle qu’il semble leur avoir attribué et sont donc pour ainsi dire les cobayes d’une expérience cinématographique (ou sociale comme on dit aujourd’hui).
« Arrive » alors (grâce à ce Saint-Esprit, le montage) l’impensable, l’imprévu tant escompté : l’équipe se réunit pour parler du tournage et plane dans la salle comme un petit air de mutinerie. On ne joue pas, on ne semble pas non plus improviser : chacun se montre « réellement » dubitatif quant aux instructions et aux intentions de Greaves. Pourquoi les techniciens se filment-ils en l’absence du cinéaste ? Comment ces séquences, que Greaves (qui n’en attendait sans doute pas tant) ajoutera deux ou trois fois au montage final, lui sont-elles parvenues ? Mystère. Il espérait que naisse de ce stratagème, de l’imprévu, un imprévu censé représenter une forme de « vérité » détaché de toute créativité. Et c’est exactement ce que son équipe (pourtant dubitative sur ses intentions) lui offrira sur un/le plateau.
Les essais se poursuivent. Greaves réclame à ses interprètes de nouvelles tentatives. Mais à l’image des techniciens, ils semblent loin d’être convaincus de ce qu’ils proposent. Ils s’agacent et commencent à ne plus prendre leur travail au sérieux. Un classique dans la direction d’acteurs : c’est quand on est fatigué, quand l’imprévu casse la routine, qu’on tente et ose des choses. Ce n’est pas forcément mieux (aucun acteur ne se montrerait performant avec des directives aussi grotesques), parce qu’il y a plus de lâcher-prise, plus d’insolence aussi, mais l’intérêt du film de Greaves se dévoile ailleurs, souvent dans les coulisses, dans le processus de création ou dans les interactions entre différents membres de l’équipe. Là où la réalité n’a pas besoin d’un script pour se manifester.
Greaves amorce ensuite avec d’autres acteurs une approche qui leur semble ridicule (ou du moins s’en amusent-ils) : il leur demande de chanter leur dialogue. Là encore, les techniciens lèvent deux ou trois sourcils, c’est à croire qu’ils n’ont jamais assisté à des cours de comédie ou à des répétitions. Parfois, on expérimente. Souvent, on trouve ainsi une certaine aisance, on découvre l’autre, on propose plus, on se dévoile. Greaves, d’après ce que j’ai compris, est un habitué de la scène new-yorkaise (il aurait été professeur et aurait des liens notamment avec l’Actors Studio). Bref, tout ça est prémédité et n’a pas vocation à être « sérieux », mais comme Greaves se place clairement (pour nous) dans une démarche d’expérimentation, elle nous paraît plus logique qu’aux victimes du cinéaste.

Des techniciens mutins
Greaves expérimente la même séquence, mais à un autre endroit du parc, assis, et malgré tout, on voit l’évolution. En somme, plus Greaves artificialise son film, dévoile et exploite sa stratégie de recherche du réel, plus il se rapproche non pas de la réalité, mais d’une illusion de réalité. C’est précisément ce qu’est le cinéma : donner une illusion du réel. La démarche tend à trouver une image du réel en faisant un film. Un documentaire, c’est le plus souvent ce qu’il cherche à faire : nous parler, peut-être pas de la réalité, mais du monde. Greaves, dans un documentaire maquillé à ceux qui en sont malgré eux acteurs, nous expose une certaine réalité d’un monde, celui du processus créatif. Le sien, mais surtout celui de ceux qui se révèlent peu convaincus de sa démarche et qui malgré tout, tels des esclaves volontaires de la vision d’un autre, acceptent d’obéir à ses demandes. Ils ne jouent pas, ils ne font pas un film, une fiction, ils participent à la vision d’un homme. Et nous, spectateurs, voyons des gens se soumettre à un autre. Et ça, c’est bien la réalité, pas une fiction. Ils obtempèrent peut-être en traînant des pieds, mais c’est peut-être aussi parce qu’on les découvre de moins en moins volontaires et impliqués, un peu comme les « acteurs » des films de Rouch oubliant la présence de la caméra, qu’on peut difficilement remettre en doute leur sincérité. Greaves expliquera plus tard qu’il pensait que demander des choses stupides à ses acteurs et techniciens les ferait sortir de leurs gonds, qu’ils exprimeraient plus directement leur incompréhension et leurs doutes. Au lieu de ça, l’équipe a pris le parti de se filmer en l’absence du cinéaste. Les acteurs tout particulièrement se sont enfermés dans une sorte de soumission volontaire, commune dans la profession, qui évoquerait presque les expériences psychologiques controversées de l’époque censées mettre en lumière la réalité d’une subordination aveugle face à des ordres dangereux émanant d’une « autorité ». (L’expérience de Milgram, c’est 1963.)
On sourit tout du long, parce que l’on comprend à chaque seconde du film qu’un seul individu (celui précisément supposé ne rien y comprendre) sait ce qu’il fait. À défaut de trouver le « réel », Symbiopsychotaxiplasm: Take One reproduit les principes de la comédie : une succession de quiproquos, d’apartés et de moments de connivence avec le spectateur. Un joli pied de nez du cinéaste, une expérience salutaire et amusante à une époque pas encore habituée aux making of (enfin presque, le film n’ayant pratiquement jamais été vu avant les années 90).