Où est la maison de mon ami ? (Lars)


The House That Jack Built
Année : 2018
Réalisation : Lars von Trier
Avec : Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman
Il faut s’appeler Lars von Trier pour oser produire un film à sketchs sur un tueur en série. Problème inévitable, comme avec beaucoup de films à sketchs, on peine à comprendre le lien logique qui réunit cette suite de meurtres grand-guignolesques. On me répondra que ce n’est pas réellement un film à sketchs, et je dirai que je doute que Lars ait construit son film autour de ce seul fil grotesque, mystique et vaseux qui prend essentiellement sa « logique » dans son épilogue. Parce que, oui, ça ressemble vraiment à un film écrit autour de meurtres sans rapport les uns avec les autres, commis par un même personnage qu’on tend peu à peu à dessiner un profil psychologique forcément dérangé, et sur quoi on a brodé un semblant de fil conducteur pour donner à voir une unité que le film ne gagnera jamais. C’est froid et mal compartimenté comme le frigo de Jack, et probablement comme Lars : seuls la mise en scène et le récit des meurtres intéressent le cinéaste danois déjà mort depuis quelques décennies, ce qui fait que, par manque d’unité, on se moque, de notre côté aussi, des liens que leur meurtrier peut avoir avec ses futures victimes. On peine surtout à comprendre ses motivations (les explications psychologiques se révèlent laborieuses et assez peu crédibles). Les spectateurs qui prennent plaisir à se voir à la place d’un psychopathe sans aucune empathie pour ses victimes doivent être rares. En tout cas, pour moi, le cinéma a pour fonction de montrer comment les gens tissent des liens, se déchirent, se rabibochent, et pourquoi. Suivre une succession de sketchs de Grand-Guignol pour voir comment Matt Dillon va s’y prendre pour tuer ses nouvelles victimes, ça ne met franchement pas en appétit. Quant à connaître les motivations refoulées de ce charmant monsieur, ça me laisse, là encore, totalement indifférent. Le film n’aura d’intérêt que pour les maniaques de tueurs en série venant y assouvir leur curiosité morbide pour les différents modes d’exécution d’un tueur — un peu comme on regarde un film porno des années 70, construit sur le même principe dramaturgique d’une suite de saynètes ou de tableaux reliés grossièrement entre eux (une scène n’étant qu’un prétexte à mettre différents personnages dans diverses situations en train de se faire des mamours).
Un mot sur la distribution parce que je n’irai pas plus loin dans le massacre afin de ne pas réveiller les instincts masochistes de Lars (je sais que tu me lis, mon kiki). Grand plaisir de retrouver Matt Dillon avec une partition pourtant difficile : jouer l’apathie d’un psychopathe apprenant lui-même à jouer l’empathie, voilà qui relève de l’impossible gageure pour un acteur. Si ce n’est pas toujours convaincant (mais s’interroger sur les excès de l’acteur revient à s’interroger sur celles du personnage… feignant, grossièrement, des émotions), ça l’est toujours plus que la jeune actrice interprétant la simplette victime du sadisme du tueur. L’actrice semble assez mal à l’aise à l’idée de jouer une imbécile et paraît bien trop sur la retenue pour être réellement aussi bête que nécessaire. Je vante souvent le mérite des acteurs capables de jouer parfaitement les imbéciles. Il y a chez eux une forme de spontanéité, de fraîcheur et d’innocence enfantine, qui est impossible à retrouver par des acteurs en contrôle, conscient de ce qu’ils font, et donc des acteurs intelligents. L’intelligence est souvent la première ennemie d’un acteur. En voyant ce personnage, je me disais que Lars von Trier avait dû fureter sur les réseaux sociaux et tomber lors de ses recherches sur la vidéo d’un type se moquant de sa petite amie incapable de comprendre un simple jeu de division avec des portions de pizza (la vidéo est ici, et le couple propose tellement de vidéos de ce type que ça sent le fake, ce qui en serait d’autant plus bluffant : en dehors du fait que ça donne une image de la femme assez exécrable, il y aurait du génie à feindre une telle bêtise). Bref, je ne saurais trop rappeler à Lars ce qu’une actrice comme Shelley Winters a été capable de faire tout au long de sa carrière. Les acteurs chez Lars, c’est comme le décor au théâtre, quand on s’ennuie et qu’on ne prête pas beaucoup plus attention à la maison que construit Jack, on ne voit que ça… Reviens au mélodrame, Lars. Le dogme de l’horreur proposé depuis quelques films peine à combler les attentes du vieux butineur que je suis, plus attiré par la lumière que par le lugubre. Bisous.

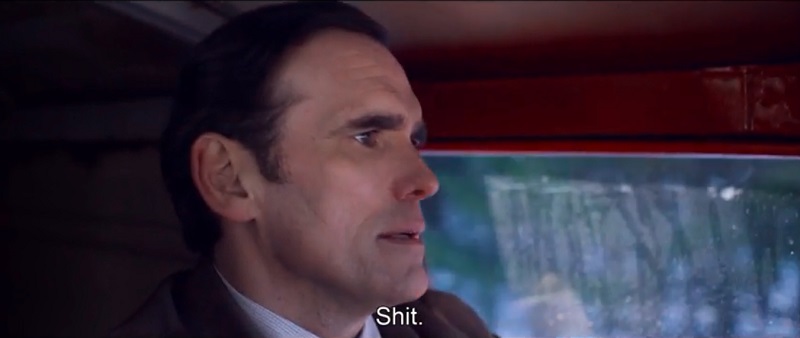


The House That Jack Built, Lars von Trier 2018 | Zentropa Entertainments, Centre National du Cinéma et de l’Image, Copenhagen Film Fund
Liens externes :
Si vous appréciez le contenu du site, pensez à me soutenir !
Réaliser un don ponctuel
Réaliser un don mensuel
Réaliser un don annuel
Choisir un montant :
Ou saisir un montant personnalisé :
Merci.
(Si vous préférez faire un don par carte/PayPal, le formulaire est sur la colonne de gauche.)
Votre contribution est appréciée.
Votre contribution est appréciée.
Faire un donFaire un don mensuelFaire un don annuel











































