Bull’s Eye

Dans ses yeux

Titre original : El secreto de sus ojos
Année : 2009
Réalisation : Juan José Campanella
Avec : Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago
— TOP FILMS —
Voilà un film pas commun. D’abord il est assez rare de voir des films argentins. Mais aussi dans la structure, il y a quelque chose qui fait qu’on met un peu de temps à rentrer dans le rythme, à comprendre le ton, ou plutôt les tons du film. Finalement on s’amuse, on s’émeut, jusqu’à cette fin parfaitement menée.
Cette fin, c’est toute l’idée qu’on peut se faire de la mise en scène (ou du récit filmé). Mettre en scène, c’est faire le choix des bonnes proportions, du bon ton, contrôler ses effets… Elle aurait pu être grotesque, et au contraire, elle est si bien menée qu’elle apparaît comme une évidence. Certains diront bien sûr, et ils n’auront rien compris, que c’est prévisible…
Oui, c’est le but que ce soit prévisible. Le récit aurait pu révéler très tôt ce dénouement dès que Benjamin arrive dans la maison de campagne de Morales. Mais ça aurait été un effet de surprise. Au contraire, le récit étire au maximum. On sait que si on est là, c’est qu’il va se passer quelque chose, et cette chose tarde à venir, on est presque chez Hitchcock… Pas compliqué donc de faire semblant d’avoir tout compris, parce qu’il nous y prépare à cette fin. Tout est bon à être un indice, donc on est à l’affût du moindre détail. Ainsi, quand Benjamin repart avec sa voiture, on a la sensation que ce n’est pas fini. On sent la révélation venir, et pour la plupart des spectateurs, on a déjà compris. Le plaisir n’en est que plus intense (et il ne servira à rien d’ajouter une musique grotesque quand la “révélation” arrivera, car ce ne sera pas une surprise, juste une confirmation).


Benjamin revoit les événements dans sa voiture, repère tout ce qui ne colle pas. C’est un peu comme si le récit montrait ses cartes pour demander au spectateur s’il les connaissait tous. Carte par carte. On a cette fois la certitude de ce dénouement, on finit par tout comprendre en même temps que lui, c’est comme un brouillard qui se dissipe, exactement comme l’effet de révélation d’Usual Suspects quand le policier remarque sur le mur tout ce qui avait éveillé l’imagination du véritable Keyser Sose. On voit avant de voir.
Le cinéma, ce n’est pas seulement des histoires. C’est surtout la manière de les raconter, et il y avait dix mille manières de procéder avec cette fin. C’est amené comme il fallait. Comme une chose qui devient évidente, plutôt qu’une surprise.
En dehors de cette fin remarquable, il faut aussi signaler tout au long du film le plaisir qu’on a à voir les personnages principaux se taquiner. Que ce soit Benjamin et son collègue alcoolique qui forment tous deux un duo comique hilarant et absurde (« Allô ? La banque du sperme, service des prêts, que puis-je faire pour vous ? — Pas moyen d’être tranquille dans cette baraque »… Et on est dans le bureau d’un juge). Ou que ce soit entre Benjamin et sa patronne, juge diplômée à “Harvard”, qui n’arrêtent pas de se dévorer des yeux, de flirter, de se taquiner tout au long du film… sans jamais rien ne s’avouer…
Oscar du meilleur film étranger bien mérité.

Dans ses yeux, Juan José Campanella 2009 El secreto de sus ojos | Tornasol Films, Haddock Films, 100 Bares
Sur La Saveur des goûts amers :
Listes :
— TOP FILMS —
Top des films en langue espagnole
Sujets & débats :
Listes sur IMDB :
✓
✓
Liens externes :


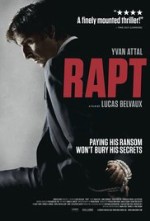 Année : 2009
Année : 2009
 Année : 2007
Année : 2007























 Année : 2007
Année : 2007


