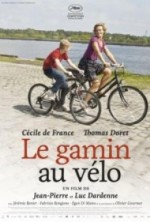Réanimation post-mortem

De l’autre côté du vent
Titre original : The Other Side of the Wind
Année : 2018
Réalisation : Orson Welles
Avec : John Huston, Oja Kodar, Peter Bogdanovich, Lilli Palmer
C’est peut-être bien inédit au rayon des films dans le film : celui réalisé « dans le film », et qu’on voit par bribes, projeté au soir d’un jour de tournage à l’équipe, des amis et des journalistes, se révèle plus réussi que le film lui-même…
D’un côté donc, le film que tourne Welles avec ces vieux potes. Vieux, c’est le terme, le seul jeunot de la bande, c’est le petit flagorneur cocaïnomane, Peter Bogdanovich (également producteur du film). Ambiance à la Robert Altman période Nashville, mais un chaos sans aucune maîtrise, comme un assemblage kaléidoscopique des bavardages faussement brillants, plein de connivences entre gens mal élevées qui ne pensent qu’à péter plus haut que le cul du voisin, des artistes quoi. Il faut imaginer un remake de Boogie Nights effectué avec des chutes de film de Cassavetes. Le montage est ignoble. Welles multiplie tellement les contrechamps syncopés que je pourrais désigner sans me tromper les trous du cul de la moitié du casting. L’idée d’user à l’infini de contrechamps quand on produit un film choral, il faut oublier. On n’a pas besoin de voir tout le monde, tout le temps. Ça charcute, ça papote pour dire des âneries, on voit rien, on comprend rien, c’est laid, ça gesticule dans tous les sens, c’est pire que dans un mauvais film de Lars von Trier période dogme95. Un film ça respire, celui-ci suffoque et nous avec lui.
Et puis entrecoupé de ces immondices verbeuses et clignotantes, on voit apparaître le film dans le film, réalisé par le personnage qu’interprète John Huston (et probablement écrit par son interprète principale, et manifestement compagne de feu Welles, l’incandescente Oja Kodar). Mademoiselle est créditée en tant que coscénariste (avec Welles), mais elle est si présente dans ce film (dans le film), qu’autant la citer comme auteure. Je doute qu’elle ait écrit la moindre ligne de ces dialogues aérophagiques, mais la respiration, c’est elle qui permet de la donner dans ce film dans le film. Bref, tout à coup l’écran s’élargit, on se demande si ce n’est pas une pub ; et en effet, c’est beau comme dans une publicité R5 à la Baule ou une autre de Drakkar Noir… Sérieusement, ce film à l’intérieur du film est lui très réussi : c’est beau et sans dialogues. Comme disait Ford cité par Leone : « Le meilleur cinéma, c’est celui où l’action est longue, et les dialogues brefs ». Le film est quasi muet et se borne à montrer une action après l’autre, parfois symbolique mais toujours assez fascinante pour ne cesser de vouloir la suivre. Dès la séquence de la boîte de nuit dans laquelle Oja Kodar se déshabille dans les toilettes (séquence très kubrickienne), ces petites séquences colorées sont des bouffées d’air pur au milieu d’autres à la limite du supportable. C’est tellement aberrant qu’il serait presque judicieux de monter ce film à l’intérieur du film et d’en faire un moyen métrage. Le matériel existe, il faudrait voler les ciseaux de Oja Kodar et redécouper tout ça.
Le plus ennuyeux dans cette étrange affaire, c’est peut-être qu’au fond on n’ait aucune idée d’à qui attribuer la paternité de ce film. Welles, Kodar, Bogdanovich, ou même Netflix… ? Je préfère donner la palme à cet animal étrange et muet, cramoisi, et aux tétons frémissants, car nue et belle de bout en bout, plutôt qu’à un autre, crevé, dont on ne sait au juste ce qu’il aurait fait de tout ce foutoir. La Kodar au moins elle existe, elle est sur pellicule, toujours bien vivante. Je ne vois que sa présence pour me consoler d’avoir assisté à un brouillon de film. Et parce qu’entre un film publicitaire mettant en scène une top-modèle nue sur la plage et un autre avec la tête de Susan Strasberg au milieu de dizaine des poivrots chantants, le choix est vite fait. (Ah, si, autre maigre consolation, la beauté de Lilli Palmer. Il y a des visages qu’on voudrait oublier — comme celui suffisant de Bogdanovich —, et il y a des reines du grand écran qu’on garde toute une vie en mémoire.) Le reste n’est que poussière soulevée par le vent…
De l’autre côté du vent, Orson Welles et Oja Kodar 2018 The Other Side of the Wind | Royal Road Entertainment, Les Films de l’Astrophore, SACI, Americas Film Conser








 A Girl at My Door
A Girl at My Door












 Année : 2017
Année : 2017

 Année : 2015
Année : 2015