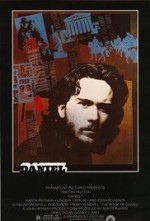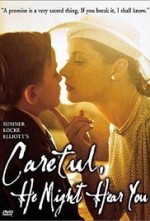« Découvre qui tu es vraiment et tu sauras comment aimer. » C’est le seul et unique conseil que PS entendra de sa tante Vanessa, mais que de torture pour en arriver jusque-là. Les conseils ne sont jamais meilleurs que quand on se les applique à soi-même après s’être lourdement trompé et quand ceux à qui on les prodigue sont alors les plus enclins à les comprendre pour avoir été victime de ces erreurs passées. Les adultes, parfois, peuvent se tromper sans penser à mal, et comme les enfants ne sont que des éponges, ils ont tout intérêt à avoir des parents capables d’assumer leurs fautes et d’agir en conséquence en appliquant pour eux-mêmes ce qu’ils préconisent pour les autres.
PS est un petit garçon d’une demi-douzaine d’années. Il vit heureux auprès de son oncle George et de sa tante Lila dans une maison de la classe moyenne australienne. Sa mère est morte, il ne l’a jamais connue ; quant à son père, chercheur d’or, il ne l’a jamais rencontré. La première scène du film illustre parfaitement son bonheur, la sécurité et l’amour que lui procure cette tante qui est comme une mère pour lui : il est dans son lit et la regarde dans la pièce voisine qui tarde à venir le border. Cette image pourrait tout autant être celui de l’amant attendant sa belle, on est dans le fantasme d’un petit garçon rêvant tendrement aux bonnes attentions de l’adulte qui lui sert de doudou, de branche, de jupon (alors que la voix off évoque l’arrivée de cette autre tante perturbatrice) ; mais déjà le rôle de la mère, en un seul geste, se définit, en posant les limites de cet amour : elle vient le border, l’embrasser, l’étreindre, mais ces gestes n’ont rien d’équivoques et le petit garçon, tout en étant rassuré de l’amour de sa « mère », comprend la différence entre la réalité, les règles, la bienséance, avec le monde des fantasmes, ceux qu’il est bon de garder pour soi. Le bonheur, le temps serein, propre à toutes les introductions d’histoires est là, posé de la plus merveilleuse des façons.
Tout change alors quand on lui apprend qu’une autre de ses tantes est de retour de Londres. Même principe, on la découvre avec les yeux éblouis de l’enfant (le jeu de montage sur les regards de l’enfant n’est pas sans rappeler ceux du début dans Docteur Jivago), une nouvelle fois on suit les petits fantasmes innocents d’un jeune garçon, s’énamourant furtivement de l’image d’une autre femme, plus coquette que sa tante Lila. Seulement là encore, en une scène, tout est dit, car un geste seul illustre les débordements et les troubles de cette tante Vanessa : au lieu de le prendre dans ses bras et le câliner, elle l’embrasse sur la bouche (un brin plus tordu puisque c’est à la russe, il faut jouer avec les limites, pas encore les dépasser). Les choses ne font alors qu’empirer puisque le père du gamin a explicitement désigné Vanessa comme sa tutrice. PS, tel le jeune Kane disant adieu à sa luge, doit changer d’école et se retrouve dans une grande maison vide où la propriétaire tente de faire respecter des règles et des usages de la haute société anglaise : PS, à l’élocution plutôt hésitante mais toujours appliqué et poli, accepte sans excès ces manières nouvelles, et se console comme il peut avec la domestique qui apprend en même temps que lui… La qualité du film à cet instant est de ne pas tomber dans la caricature et la facilité, car PS peut encore se rendre chez ceux qu’ils considèrent comme ses véritables parents, Lila et George.

Commence alors une petite guéguerre assez commune dans les familles « décomposées », entre les différents adultes pour affirmer son attachement auprès du bambin. Et pendant ce temps, la relation entre Vanessa et PS erre dans une zone dangereuse et aux limites floues. Durant un orage presque annonciateur de la fin de la belle, ce n’est pas PS qui court dans les bras de sa tante, mais bien elle qui vient se blottir contre lui. Pire, on comprend dans ses délires de petite folle qu’elle a toujours été amoureuse de Logan, le père de PS… Le doudou, c’est lui, et les rôles s’inversent. Vanessa ne le comprend pas encore, mais cet amour qu’elle porte pour le garçon n’est pas celui d’une mère, mais d’une femme contrariée par l’amour déçu de sa vie.
Après quelques péripéties (implication du juge et apparition du père), il faudra que Vanessa fasse l’expérience de la cruauté de PS pour qu’elle comprenne que son neveu serait mieux chez sa sœur. C’est le sens du conseil qu’elle donnera alors à PS : il faut découvrir qui on est pour être capable d’aimer quelqu’un d’autre. Autrement dit, ne comprenant pas pourquoi elle tenait tant à s’attacher sa garde, elle lui refusait du même coup l’amour qu’elle prétendait pouvoir lui donner. Le laisser à Lily, c’était ainsi la plus belle preuve d’amour qu’elle pouvait lui faire. Et les enfants étant donc des éponges…, après avoir répondu à la cruauté de Vanessa par la cruauté, PS peut désormais rentrer chez lui (retour du héros toussa) et comprendre mieux qui il est dans une scène finale où il fera accepter à sa tante et à son oncle, un autre nom que celui de PS, celui que sa mère lui avait donné (enfin celui qu’il tenait de son grand-père…), William, qu’il transformera plus familièrement en Bill. « Voilà qui je suis : Bill. » Et mettant ainsi à l’épreuve ses « parents », chacun accepte « qui il est » et tout le monde peut s’aimer à nouveau comme au premier jour, ou presque. Les masques sont tombés, chacun a reconnu le « héros ».
Du point de vue de la dramaturgie et du sens, on touche donc de près l’excellence. Mais ce qui est encore plus remarquable, c’est l’exécution. On le voit, si l’intérêt de l’histoire est de jouer avec les limites, suggérant le pire sans jamais à avoir à les montrer, il faut pour cela passer par la mise en scène. Le jeu de regards, les attentions, tout ça sont des détails qui en disent beaucoup plus souvent que ce qu’on raconte ostensiblement. Tout est ainsi sous-entendu, et derrière chaque réplique se cache en permanence une intention qui ne se laisse pas toujours appréhender. Il y a ce qu’on dit, ce qu’on montre, ce qu’on voudrait montrer, ce qu’on voudrait dire et qu’on ne dit pas, ce qu’on essaie même de faire dire à un enfant… Pour suggérer ces errances relationnelles, il faut un sacré savoir-faire et une bonne dose de justesse dans la direction d’acteurs. C’est une chose déjà d’assez remarquable avec des acteurs adultes, mais réussir en plus à instiller ces incertitudes dans la caboche d’un petit garçon ça frôle la perfection. Les gamins ont pour eux le pouvoir de leur imagination si on arrive à en ouvrir les portes, au metteur en scène ensuite d’arriver à dompter ce fouillis imaginatif. L’astuce ici résidait peut-être dans la nécessité de produire chez le gamin certaines hésitations et de compter sur ce qu’ont de plus faux ou d’automatique certains enfants quand ils répètent leur leçon (en particulier concernant la politesse). PS est un rêveur, non un rebelle, si bien qu’il tient à contenter ses proches, et répète ainsi les formules de politesse avec application mais sans forcément grande conviction. Et puis parfois, il y a des jaillissements imprévus qui sont là au contraire le propre des enfants qui ne font plus attention à ce qu’ils disent. Cette spontanéité, mêlée à son exact opposé, concourt à produire sur nous spectateur une forte impression de vraisemblance. Plusieurs fois, par ailleurs, les acteurs nous gratifient de quelques instants de grâce, souvent poétiques, qu’on ne rencontre que dans les grands films.


Il n’y a pas de grand film sans grande musique, à noter donc l’excellente partition musicale de Ray Cook, omniprésente, discrète et juste ; et sans grande photo, celle de John Seale (comme pour le reste, de parfaits inconnus). Ajouter à ça quelques surimpressions, des montages-séquences efficaces, et on croirait presque voir un film de David Lean.
Mais j’insiste, rarement j’aurais vu un film définir aussi bien le rôle du parent, en particulier celui de la mère. Ni génitrice, ni accoucheuse, ni nourrice, ni bonniche, ni régente, ni copine, ni marâtre : une mère, c’est celle qui à la fois aime et montre les limites, celle qui aime pondérément, parce qu’aimer, c’est d’abord apprendre à respecter l’autre, pour le laisser se définir, ou se découvrir, seul, affranchi de l’amour parfois envahissant de l’autre. Parce que les enfants ne font rien d’autre que reproduire, non pas ce qu’on leur dit ou demande, mais montre. L’amour sans limite n’est que ruine de l’âme… (hum), un masque qu’on porte pour se tromper soi-même. Une illusion capable de nous ronger de l’intérieur quand on croit n’y voir que bienveillance et tendresse.
« Découvrir qui on est pour savoir comment aimer l’autre. » Tu as compris ? Alors au lit maintenant.


Careful, He Might Hear You, Carl Schultz 1983 | Syme International Productions, New South Wales Film Corporation






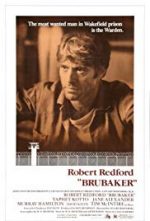 Année : 1980
Année : 1980




 Année : 1984
Année : 1984


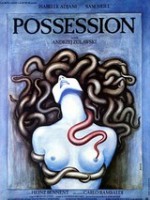





 Année : 1983
Année : 1983