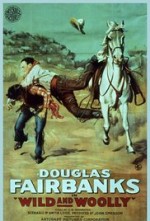Le Pauvre Amour
Titre original : True Heart Susie
Année : 1919
Réalisation : D.W. Griffith
Avec : Lillian Gish, Robert Harron, Wilbur Higby
La même année que Le Lys brisé, et probablement le même niveau technique pour Griffith : ici encore un ou deux faux raccords (dont un surprenant parce qu’il me semble qu’il aurait pu y remédier en forçant un peu sur la continuité, à croire que ça ne heurtait pas encore le regard), des étonnants passages de plans moyens à plan rapprochés dans l’axe (produisant là encore un faux raccord pour un œil contemporain : dans une composition classique on doit respecter l’échelle de plan et ici Griffith zappe le plan américain, donc le passage au plan rapproché saute à la figure ; effet sans doute plus violent à l’époque parce que les plans rapprochés y sont tout neufs, mais ça se justifie aussi par la situation), et puis pour le positif, Griffith reste le prince du montage alterné (celui à la fin mêlant le mari cherchant sa femme et cette même femme réfugiée chez Lillian Gish, c’est un vrai bijou, d’une modernité folle).
Le meilleur est encore ailleurs. Il faut reconnaître, et c’est peut-être le mélange étonnant de comédie et de drame propice à une mise en scène (je parle de la direction d’acteurs) riche, mais je ne me souvenais pas d’un Griffith (bien qu’il soit lui-même acteur, comme la plupart des meilleurs metteurs en scène de l’époque) aussi bon à diriger des acteurs. Et pas une direction théâtrale où les acteurs ont toute l’amplitude habituelle de la scène pour étaler dans des plans sans coupe tout leur talent, mais bien un jeu typique du cinéma, frustrant pour les acteurs, qui n’est fait que de petits bouts de scène, d’actions et de réactions (l’accent nécessaire lors des moments importants étant juste souligné par un rythme plus lent et un plan rapproché). Il n’y a que ça ici, et la meilleure dans ce catalogue de mimiques cinématographiques, c’est bien sûr Lillian Gish.
Le jeu des acteurs du muet passe souvent pour être théâtral, pour n’être qu’une simple pantomime, je crois pourtant avoir vu que très rarement une telle performance chez une actrice au cinéma, parlant compris. Gish passe d’un registre à l’autre avec une aisance déconcertante, offrant sans cesse une palette d’expressions collant merveilleusement à la situation et à son personnage, le tout toujours dans une justesse confondante.
Elle commence en adolescente timide et amoureuse, semble imiter, par la démarche cahotante et des petits tics ou rictus (une jambe qui se dresse soudain), Chaplin, puis elle gagne en maturité, cherche à plaire à l’homme qu’elle aime tout en acceptant avec dignité son choix de se marier avec une autre, continue de jouer le rôle de meilleure amie pour l’un et pour l’autre… Il faut la voir surtout pleurer à chaudes larmes, ou plutôt comme insistait toujours un de mes profs de théâtre : « se retenir de pleurer ». Parce que oui, on est bien plus émus par un personnage qui se retient de pleurer, et c’est bien plus dur à reproduire pour un acteur. Non seulement Lillian Gish arrive à pleurer tout en nous donnant l’impression qu’elle cherche à retenir ses larmes, mais elle arrive en plus de tout ça à rester simple, juste, nous laissant là penser que c’est la chose la plus facile au monde… Il faut la voir aussi l’œil en coin (comme elle sait le faire si souvent et pour exprimer tant de choses différentes), exprimer quelque chose entre la méfiance, le dégoût, la jalousie, l’envie de meurtre, quand elle regarde son amie, la femme de celle qu’elle aime, échouée dans son lit après une escapade nocturne limite adultérine. Il y a du génie là-dedans, un génie comme presque toujours, qui passe par la fantaisie.
Le Pauvre Amour, D.W. Griffith 1919 True Heart Susie | D.W. Griffith Productions
Listes sur IMDb :
✓
✓









 Année : 1929
Année : 1929














 Année : 1917
Année : 1917